Petite histoire du Piémont (début)
La région d’Italie appelée « Piemonte » ne correspond en réalité à aucune entité historique ou géographique naturelle, elle est le fruit d’événements qui lui ont donné ses frontières actuelles. Les Romains avaient fait un territoire administratif qui allait de la mer au Pô, c’était le pays ligure ; au Nord du Pô se trouvaient les populations celtes de la Transpadanie. Quant aux vallées alpines, elles étaient un avant-poste de la Gaule. Au moyen-âge, la région fit partie de la « Langobardia », contractée en « Lombardie », qui allait des Alpes à la marche de Trévise.
Le nom de « Piémont » n’apparaît qu’en 1193, mais on continua à parler des « lombards du Piémont » ; ce territoire était divisé entre deux organismes politiques, les comtes de Savoie ou d’Acaia, et les Anjou, comtes de Provence puis rois de Sicile ; mais à partir de la défaite de la famille d’Anjou au XIVe siècle, et de la disparition de la famille d’Acaia (1424), le seul « prince » qui subsiste est l’héritier de la famille de Savoie, Amédée IX ; à partir de ce moment, le « Piémont » s’assimile à l’État des Savoie, variable en extension : la région d’Asti n’est intégrée qu’au début du XVIe siècle, le Monferrato est conquis en 1613, mais au XVIIIe siècle, Novara est encore considérée comme terre « milanaise ».
Le Piémont sera aussi délimité par l’extension de son dialecte, le « piemontese », considéré comme plus rustique et grossier : en 1740, le président De Brosses, visitant Turin, dit que « le piémontais … est un langage pauvre, comme l’avouent ceux-là mêmes qui le parlent ». Aujourd’hui encore, c’est la Sesia qui sépare la zone de dialecte piémontais du milanais, comme la Bormida sépare le piémontais du ligure.
Quant aux limites actuelles de la région, elles ne remontent qu’à une soixantaine d’années, quand le Val d’Aoste fut constitué en région autonome par rapport au Piémont.
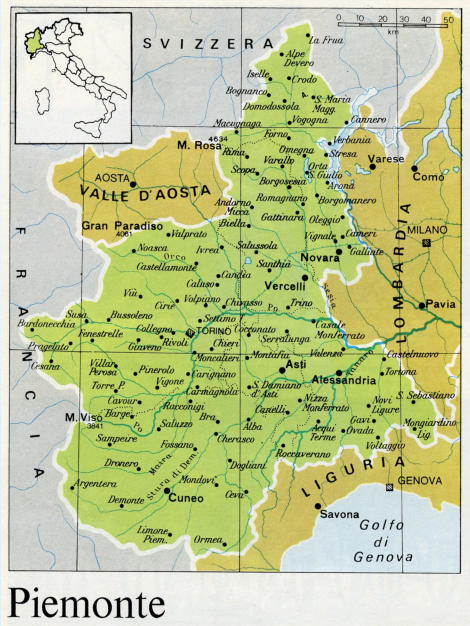
1. De la préhistoire à la conquête romaine
a) La préhistoire
L’apparition des hommes dans le Piémont, ne remonte qu’à environ 200.000 ans, la fin de cette partie de la préhistoire appelée Paléolithique inférieur ; c’est donc très récent par rapport aux plus de 2 millions d’années de présence de l’homme en Afrique. Le site le plus ancien où l’on trouve des armes et des outils en pierre taillée est celui de Trino Vercellese, dans un bivouac de chasseurs alors nomades, probablement du genre Homo erectus, pas encore sapiens. Les plaines étaient alors encore remplies d’éléphants, de mammouths, d’hippopotames, de rhinocéros, de cerfs, de mégacéros, d’urus, de bisons, de chevaux sauvages, de marmottes, et d’ours des cavernes dans les régions rocheuses. Le climat était plus froid qu’aujourd’hui.
Les premières traces d’Homo sapiens remontent à la dernière période de glaciation de notre planète, il y a environ 100.000 ans (glaciation de Würm), sous la forme de l’Homo neanderthalensis, qui vivent de chasse et de cueillette, et reviennent régulièrement dans les mêmes bivouacs : on retrouve le premier crâne d’homme de Neandertal au début de la Val Sesia, le plus ancien d’Italie du Nord. Les néanderthaliens sont supplantés par l’Homo sapiens sapiens vers il y a de 40.000 à 30.000 ans (Paléolithique supérieur), à une époque où l’ère glaciale rend la zone des Alpes et des Préalpes peu adaptée à la présence humaine. Les groupes de chasseurs encore nomades ne reviennent que vers 20.000 à 10.000 av.J.C. dans la plaine qui est alors une lande froide, avec peu de végétation, beaucoup de cours d’eau et de marais, avec une faune moins préhistorique, encore quelques mammouths et de grands herbivores, comme le bœuf sauvage et le cerf mégacéros.
Les glaciers se retirent vers 8.000 av.J.C., la plaine se couvre de forêts de conifères, de chênes, de hêtres et d’érables ; les lacs morainiques d’aujourd’hui se forment alors ; la plaine, steppe humide, se peuple d’herbivores, comme les ânes sauvages, proie facile qui attire les chasseurs, les élans, les bisons, les cerfs et les bouquetins.
Cette période, dite du Mésolithique, se caractérise par l’invention de l’arc, qui facilite la chasse ; ce qui attire le plus, ce sont les lacs, riches en faune, et les Préalpes, plus riches en bétail que les plaines trop marécageuses et trop couvertes de forêts impénétrables.
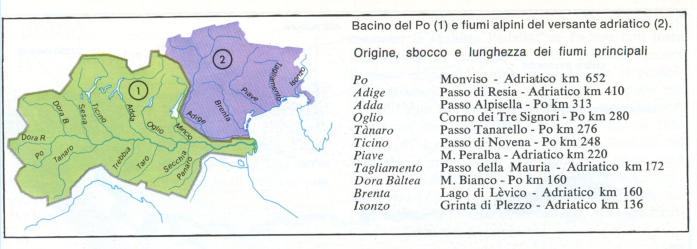
b) Les paysans bergers du Néolithique
Vers 5.000 av.J.C., la révolution néolithique se caractérise par l’introduction de l’agriculture et de l’élevage et la fabrication de vaisselle en céramique, des milliers d’années après leur apparition en Orient. Les différentes phases sont caractérisées par les ornements des céramiques grâce auxquels on commence à identifier les premiers sites : le village de cabanes près d’Alba, avec ses céramiques de culture dite de la « Céramique imprimée ou gravée », en provenance probable des cultures de la côte ligure et de la France du Sud ; le village fabriquait aussi de petites haches en pierre verte polie. Beaucoup d’autres sites occupent plutôt la moyenne montagne (Chiomonte, – vers Susa –, Mergozzo, – au nord du lac Majeur – et Briona, – au nord de Novare ) : haches, lames de couteaux en silex, faucilles en silex et en quartz, vases, écuelles, éléments de métiers à tisser, bêches en bois, charrues. On élevait des chèvres, des moutons et des porcs, les chiens étaient animaux de chasse et de compagnie, mais aussi … viande comestible ! On cultivait quelques céréales, l’épeautre, le blé tendre, l’orge et le millet. Les morts étaient ensevelis avec un minimum de trousseau (bracelets, haches, etc.) ; on commence à pratiquer la peinture rupestre : Val Germanasca, près de Pinerolo, vers Suse et à la Rocca di Cavour (au Sud de Pinerolo).
La métallurgie apparaît au IVe millénaire, avec l’usage du cuivre (Calcolithique ou énéolithique = âge de la pierre et du cuivre) ; apparaissent les premières nécropoles, avec colliers de dents, outils en pierre, vaisselle (Alba) ; la présence de vases de type « Campaniforme » atteste que les échanges se développaient entre les divers groupes humains.
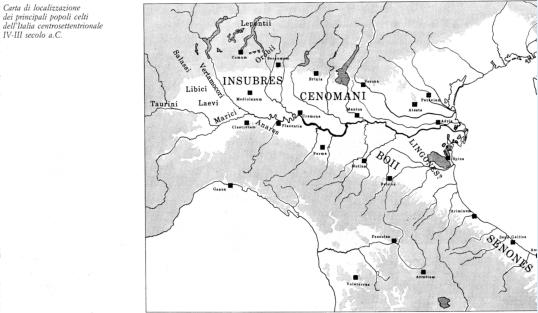
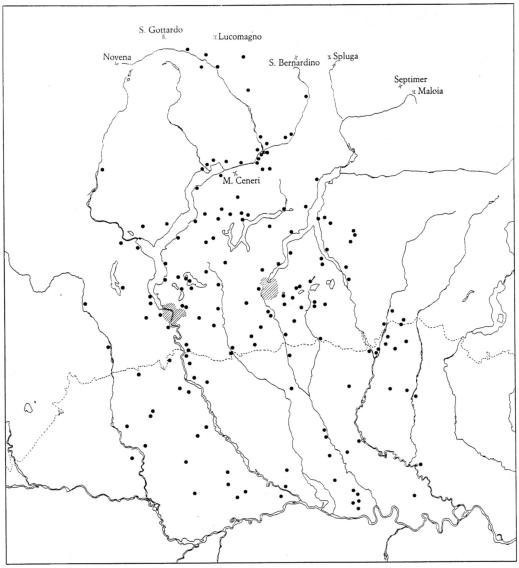
c) Les villages sur pilotis de l’âge de bronze
Vers 2.000 av J.C., le bronze est découvert et prend une place importante. Entre 1600 et 700 av. J.C., un refroidissement climatique entraîne un climat peu pluvieux, donc des lacs plus bas qu’actuellement, et la population, qui a augmenté, s’installe au bord des lacs pour exploiter la pêche et la fertilité des terrains couverts d’alluvions ; pour éviter les dangers des inondations, elle construit des villages sur pilotis, dans le Canavese (région de Ciriè), à Trana (à l’Est de Turin), au lac de Viverone (entre Ivrea et Vercelli) : village de 4 grandes cabanes, armes en bronze, poignards, haches, épées, pointes de lances et de flèches, rasoirs et bijoux ; il s’agit d’une culture avancée, appelée « de Viverone ». Dans les lits des fleuves on trouve des pirogues ; des artisans itinérants maintenaient des contacts avec l’Europe continentale ; l’agriculture et l’élevage se développent : épeautre, blé, orge, avoine, millet, et une céréale nouvelle, le seigle, mais aussi des légumineuses, petits pois, lentilles, et chanvre, lin pour le tissage. Les noisetiers prolifèrent, on consomme les bovins, les ovins … et les chiens.
On trouve les premières traces de cultes adressés à des êtres divins, à qui l’on consacre des armes. On commence à pratiquer la crémation des morts et on dépose les cendres dans des urnes de terre cuite (Cesto, près de Novare, Alexandrie, Alba).
La civilisation des villages sur pilotis disparaît vers le VIIIe siècle av. J.C. pour raisons climatiques : températures plus froides, augmentation des pluies et donc élévation du niveau des lacs. Les habitants se réfugient plus haut dans les collines des Préalpes et commencent à modeler la nature : terrassements rendus nécessaires par les différences de niveau. L’homme cesse d’être uniquement déterminé par les forces climatiques.
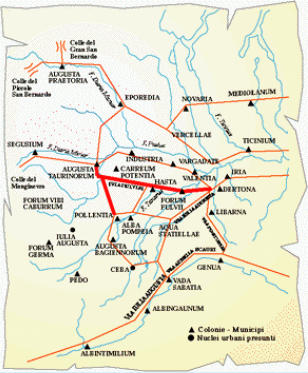
d) Ligures et Celtes
Les Ligures étaient un ensemble de tribus qui parlaient des langues proches des langues celtiques et qui avaient peuplé toute la zone maritime, du Rhône aux Apennins de Toscane et d’Émilie. Peu à peu ils pénètrent le nord des Apennins jusqu’au Pô. Au contraire, au nord du Pô, arrivent des tribus d’origine celtique qui donneront naissance aux Insubres dans la partie orientale et plus à l’Ouest aux Salasses et aux « Taurini » qui donneront leur nom à Turin, originaires probablement de la Gaule transalpine. On obtint ainsi trois zones différentes qui eurent une histoire séparée. Entre la Sesia et le Ticino, les Celtes s’installent à partir du VIIIe-VIIe siècles av. J.C. et forment la civilisation dite de Golasecca (village au sud du lac Majeur) qui va du bassin du Ticino jusqu’à Côme et Lugano, de la Sesia à l’Adda (la rivière qui sort du lac de Côme à Lecco et se jette dans le Pô à Lodi). Leurs inscriptions sont de dérivation étrusque, mais appartiennent à une langue celtique. On trouve à Castelletto Ticino la première tombe piémontaise d’un homme dont on connaît le nom, Kosios, contenant en particulier un verre à boire gravé. Cette population celtique, concentrée d’abord dans la zone préalpine, envahit peu à peu la plaine, société stratifiée d’où émerge une couche de princes et nobles armés (voir les tombes de Sesto Calende qui présentent des restes de chars de guerre et des objets d’importation qui révèlent leur état social élevé). Cela est lié à un développement des échanges sur cette voie de communication importante qu’était le Ticino, joignant l’Italie centrale et l’Europe continentale ; on importait donc de l’Étrurie (amphores et céramiques, casques, vases, joyaux en bronze, ambre et verre). Cette civilisation représente la première ouverture de la zone occidentale de la plaine du Pô aux civilisations plus avancées de l’Italie péninsulaire (en particulier, la première tentative d’utiliser l’écriture, comme sur le verre de Kosios, antérieur à 550 av. J.C.). Ces échanges leur apportent la connaissance du vin, tandis que l’on utilisait jusque-là la bière rouge, fabriquée à partir de l’orge. Le site de Castelletto Ticino est par ailleurs la première concentration de population de type urbain, sur une surface de 90 hectares, atteignant probablement jusqu’à 3000 habitants, vivant non plus d’agriculture mais de commerce, phénomène nouveau dans cette zone arriérée.
Dans la province de Turin, en vallée d’Aoste et autour de Biella, une culture celte venue de l’autre côté des Alpes pénètre la zone de la culture de Golasecca. Elle se caractérise par les tombes à inhumation (alors qu’à Golasecca on pratiquait la crémation) ; dans les tombes de Crissolo (au sud de Pinerolo), les morts portent des armilles (bracelets) de type français, et on trouve des céramiques qui imitent celles des Grecs de Marseille. Il y a donc des pénétrations de tribus venues de l’ouest des Alpes, dues au caractère arriéré de la culture de cette partie du Piémont, sans relations avec l’Étrurie et le monde italique.
Les Ligures qui occupent le Sud du Pô sont aussi pauvres et peu développées que les tribus du nord-ouest ; leurs céréales sont les plus pauvres comme le millet et, plus tard, le seigle avec lequel ils fabriquent un pain noir qui dégoûtait Pline ; il y eut beaucoup de mercenaires ligures dans les troupes des Carthaginois et des Grecs d’Occident ; une différence : ils continuaient à pratiquer l’incinération. Et pourtant, le Tanaro était une grande zone de navigation, à travers laquelle passait le commerce entre la Gaule et l’Étrurie et le centre de la péninsule italienne (traces de céramiques, de stèles et d’armes étrusques) ; ils furent à l’origine de la fondation du port de Gênes ; mais les paysans ligures restèrent largement étrangers à ce circuit d’échanges.

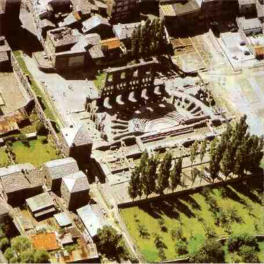
e) Les invasions gauloises
À partir des Ve et IVe siècles av. J.C., la prospérité commerciale et démographique de l’Ouest du Ticino décline et se déplace plus à l’Est où se formera le site de Mediolanum (Milan), et plus à l’Ouest vers la Sesia : le niveau du lac Majeur a monté et la navigabilité du Ticino a diminué, et les Gaulois porteurs de la culture dite « de Hallstatt » commencent à s’installer, bandes de brigands, pilleurs et mercenaires bien armés. Mais l’invasion gauloise devient massive au IVe siècle, poussant jusqu’à Rome (conquise en 386 av. J.C.). On sait peu de choses des Celtes, parce qu’ils n’avaient pas de civilisation écrite, et on ne les connaît souvent qu’à travers des auteurs grecs ou latins postérieurs. Mais il est certain que, malgré le « bastion protecteur » des Alpes et l’aspect effrayant des montagnes, ils franchissaient depuis longtemps la barrière des Alpes, attirés par le climat du Sud, les figues, le vin et l’huile ; les Alpes étaient alors habitées depuis des siècles par des populations de bergers qui s’étaient éloignés de la plaine marécageuse, et cette présence facilita le franchissement de la montagne, non plus seulement par des individus, mais par des groupes de centaines de milliers de Celtes transalpins, et une communication entre les civilisations du Sud, italiques et étrusques (qui étaient présents aussi dans la plaine du Pô), et les civilisations celtes du Nord.
L’impact culturel de ces passages de masse est énorme, la culture dite de La Tène est largement adoptée par les populations indigènes ; le rituel de la crémation laisse place à celui de l’inhumation ; l’ensemble des territoires insubres est alors considéré comme gaulois par les Romains, tandis que les Gaulois Boies et Senones envahissent l’Est de la plaine du Pô et le Centre Est. Il se constitue une fédération des tribus organisées sur le mode gaulois sous la dépendance d’un prince ou d’un roi, qui bat monnaie (drachmes) ; les paysans commencent à utiliser la charrue à soc ; l’oppidum fortifié de Vercelli est construit, mais l’essentiel de la population est encore rural, pratiquant déjà une forme de transhumance des troupeaux vers les pâturages alpins qui dure jusqu’à aujourd’hui. On voit apparaître des dieux gaulois comme Belenos (Vallée de Suse), dont les cultes s’ajoutent aux anciens cultes locaux, comme celui du dieu Taureau, lié à la foudre et à l’orage et protecteur des sommets et des cols.
Les tribus ligures sont repoussées sur les hauteurs vers les pentes de l’Apennin, où elles s’appauvrissent, se limitant à l’élevage et au mercenariat (forme d’émigration des jeunes) ; elles maintiennent pourtant une identité différente de celle des Celtes : crémation des morts, pas de confédération entre les tribus, pas d’élite princière, bien qu’elles adoptent souvent la céramique et les drachmes celtiques du Nord du Pô.


f) La conquête romaine
Les Romains envahissent peu à peu le Piémont, la soumission des Insubres s’achève au IIe siècle av. J.C. sans destructions ni déportations ; la soumission des Ligures sera plus longue, plus dévastatrice, avec massacres, déportations, expropriations et immigration de colons romains.
Les Romains avaient avancé vers le Nord dès le IVe siècle : traité de paix avec les Senones en 332, défaite des Gaulois Boi en 283, fondation de Rimini en 268. L’avancée des Romains est marquée par les défaites insubres de 225 av. J.C. à Talamona (au nord-est de Lecco) et à Clastidium (près de Pavie). Mais c’est alors le moment de la guerre punique, Hannibal détruit le site des Taurini, et la défaite de Carthage ne se produit qu’en 201 av. J.C. Une nouvelle insurrection des Insubres se produit alors, défaite entre 198 et 194 av. J.C. (Piacenza, Cremona). Les Insubres se soumettent alors, et par un traité, obtiennent de conserver leur autonomie, mais reconnaissent la direction de Rome et fournissent des hommes à son armée ; ils s’adaptent peu à peu aux coutumes romaines et au mode de vie romain. Les accords ne permettaient pas aux Romains de fonder des villes, et l’est du Piémont reste essentiellement rural. Cela n’empêche pas une intégration socio-économique dans le monde romain, par l’arrivée d’hommes d’affaires romains qui épousent des femmes indigènes ; ils commercent en utilisant une monnaie d’argent battue par les Romains pour toute la Gaule Cisalpine.
En 89 av. J.C., la citoyenneté romaine est accordée à ces alliés fidèles : cela se traduit par une urbanisation plus importante (Vercelli et Novara = ville nouvelle), et par une transformation des anciens chefs de tribus en magistrats municipaux romains.
Dans la zone ligure, au sud du Pô, la victoire romaine fut plus difficile : relief plus âpre, pas de confédération des tribus avec laquelle négocier ; les Romains durent conquérir la région par le fer et le feu, brûlant les récoltes, arrachant les vignes, expropriant les propriétaires des terres les plus riches au profit de colons romains, vendant les hommes comme esclaves. C’est donc cette région, jusqu’à Asti et Alessandria qui se dépeupla le plus et fut la plus colonisée par des Romains, qui obtiennent 10 jugères (= jugerium = arpent = 26 ares), soit 2 hectares et demi, ou par des Latins, qui obtiennent 3 jugères ; pour les vétérans de la légion, on pratiqua la « centuriation », division du territoire en « centuriae » de 50 hectares, séparées par des routes et des canaux dont on voit encore la trace aujourd’hui.
De grandes voies sont ouvertes, la Via Postumia, de Gênes à Piacenza puis Aquileia, la Via Fulvia, de Aderthona (Tortona) à Augusta Taurinorum (Torino), avec une bretelle de Turin à Pollenda (Pollenzo à l’est d’Alba). Les villes se développent : Aderthona, Libarna (à côté de Serravalle Scrivia), Hasta (Asti), Carreum (Chieti), Alba Pompeia (Alba). Cela attira de grands entrepreneurs intéressés par les potentialités vinicoles et par une force de travail bon marché masculine et féminine.
La colonisation du territoire des Salasses au nord-ouest du Piémont fut plus longue et difficile ; les Romains étaient intéressés par la zone aurifère de Biella, et ils instaurent peu à peu des centuriations. Une invasion des Cimbres est anéantie en 101 av. J.C. près de Vercelli, et les Romains fondent alors Eporedia (Ivrea) au centre d’une zone de 2000 colons.


2. D’Auguste au christianisme
Au Ier siècle av.J.C., tout le nord de l’Italie est organisé en « Gaule Cisalpine », soumise à un magistrat ayant pleins pouvoirs : ce n’était pas encore tout à fait une partie de l’Italie. Jules César fut ce magistrat pendant 10 ans et c’est lui qui intégra vraiment le territoire dans celui de Rome : il crée des villes nouvelles, dont Caburrum (Cavour), et en 49 av. J.C. fait donner la citoyenneté romaine aux habitants de la région ; il fait de Turin un camp militaire de 300 légionnaires, avant-poste pour la conquête de la Gaule. Mais c’est seulement sous Auguste que les Romains prirent complètement le contrôle du massif alpin : une dernière guerre les opposa aux Salasses, qui contrôlaient encore les cols, de 29 à 25 av. J.C., guerre très dure qui se termina par une vente en esclavage de 44.000 hommes et par la remise de terres à 3000 vétérans (Fondation d’Augusta Praetoria, Aoste). Au contraire la vallée de Suse fut absorbée par accord avec le roi des tribus locales nommé préfet d’Auguste à Segusium (Suse).
Plus difficile fut l’intégration des tribus ligures du sud. En 6 av. J.C., Auguste fit édifier le trophée de La Turbie avec la liste de tous les peuples alpins vaincus pendant la guerre, et la région n’obtint que le statut de droit « latin ».
C’est sous Auguste que commença la réorganisation administrative de l’Italie en 11 régions : le Piémont est encore loin d’exister ! Le Nord est divisé entre la Région IX, la Ligurie qui comprend le sud de l’actuel Piémont et la Région XI, la Transpadanie qui inclut une partie de la Lombardie.
L’intégration ne fut pas seulement administrative, mais aussi économique et démographique : le peuplement est restructuré par la pratique de la centuriation, remise de terres à des vétérans de la légion romaine, en vallée d’Aoste, dans le territoire des Salasses, autour de Biella, Turin, Tortona, Libarna, etc. La centuriation de Turin comporta 1000 centuries de 50 hectares l’une, qui furent distribuées à 3000 vétérans ; le déboisement, l’irrigation, la construction de routes et de canaux, le recensement à des fins fiscales accompagnaient la centuriation. Les villes nouvelles se développent, surtout Aoste et Turin, la plus grande ville créée dans le Nord après Milan, et qui prend plus une fonction de propagande qu’une fonction militaire. Le Pô fut rendu navigable par Auguste, et constitua une grande voie de communication entre Orient et Occident ; la Via Postumia est développée en Via Iulia Augusta qui rejoignait la côte ligure par Plaisance, Tortona et Acqui.
La période de paix qui se prolonge jusqu’aux Antonins, aux Ier et IIe siècles, favorisa le développement du tissu urbain selon les conceptions romaines, c’est-à-dire avec aqueducs, théâtres, amphithéâtres, monuments publics. La Région IX comprend 13 centres, dont : Tortona (Dertona), Asti (Hasta), Libarna, Alba (Alba Pompeia), Acqui Terme (Aquae Statiellae), Pollenzo (Pollentia), Bene Vagienna (Augusta Bagiennorum dans l’ancien territoire des Bagienni, à l’est de Cuneo), Chieri (Carreum Potentia, près de Turin), Monteu da Pô (Industria, à l’est de Turin), Borgo San Dalmazzo (Pedona, au sud de Cuneo), Villa del Foro (Forum Fluvii, au sud d’Alexandrie), La Région XI comprend : Novare (Novaria), Ivrea (Eporedia), Torino (Augusta Taurinorum), Aosta (Augusta Praetoria), Vercelli (Vercellae), Sanfront (Forum Vibii Caburrum, à l’Ouest de Saluzzo) ; un cas à part est celui de Suse (Segusium), peu à peu intégrée dans l’orbite romaine, mais qui appartenait à la préfecture des Alpes Cottiennes, et était une ville gauloise. C’étaient encore de petites agglomérations : Turin mesurait 760 m. par 720, Aoste 727 m. par 573, Novare 600 m. par 500. La ville est divisée en îlots réguliers, 72 à Turin dont 6 ou 8 occupés par le Forum, 64 à Aoste, 52 à Alba, 43 à Libarna.
Les maisons étaient construites sur un socle de pierre, des murs d’argile avec des cadres de bois, et des toits de tuiles ; dans les maisons pauvres, le sol était en terre battue ; elles ouvraient sur une cour parfois équipée d’un puits. Les villes étaient souvent dotées d’un théâtre de quelques milliers de places (3000 à Turin, Aoste, Bene Viagenna, 4000 à Libarna, 4500 à Pollentia). Les amphithéâtres étaient plus grands, 16.000 places à Pollentia, 10 à 15.000 à Ivrea. La plupart des villes avaient un aqueduc ou un système d’approvisionnement en eau auquel s’associait souvent un ensemble thermal. Les enceintes avaient souvent plus une fonction symbolique et de délimitation de l’espace urbain qu’une fonction de défense militaire ; on tendait à ne fortifier que le noyau central de la ville, comme à Suse. Beaucoup de ces villes ont disparu peu à peu ou à l’occasion d’une crise ; une ville comme Industria ne subsiste que parce qu’elle était aussi un centre de pèlerinage religieux, grâce à un sanctuaire à Isis, pour lequel elle fabriquait des statuettes en bronze.
On connaît moins le monde rural. Il comportait peu de villae rusticae, propriétés de moyenne grandeur qui employaient une douzaine de personnes, surtout dans les zones vinicoles. Les petits propriétaires vivaient dans de petits villages, vici, ou dans des cabanes isolées de briques ou de bois et argile crue ; ils cultivaient des céréales, millet, épeautre, seigle et pratiquaient l’élevage, souvent ovin. Dans les zones de plus haute montagne, les restes de population salasse ne s’assimilent au monde romain que vers la moitié du Ier siècle apr. J.C. ; ces paysans vivaient dans un relatif bien-être, si on en croit les objets trouvés dans les tombes, statuettes de terre cuite, poupées, colliers d’ambre dans les tombes féminines, qui étaient censés protéger du goitre fréquent dans ces régions alpines. Les zones les plus riches étaient celles de production de vin, Monferrato et Langhe ; Alba produisait un vin apprécié des Romains ; on faisait pousser la vigne sur des supports d’arbres. Les fromages et les tissus de laine grossière étaient exportés, de même que les vêtements noirs de deuil. À partir des IIe et IIIe siècles, les petits propriétaires subissent la crise agricole générale dans tout l’empire, et seuls les grands propriétaires de « latifondi » s’enrichissent encore.
Ce sont ces derniers qui occupent le pouvoir ; plusieurs seront recrutés pour le Sénat, et certains parviennent même à la fonction de consul, comme Quintus Vibius Crispus, de Vercelli, évoqué par Tacite comme un homme « riche, puissant et plus célèbre qu’honnête », sous Néron et Vespasien. Caius Rutilius Gallicus fut légat impérial en Asie, Afrique et Allemagne, plusieurs fois consul et préfet de Rome en 89 ; Quintus Glizius Agricola fut commandant de légion, consul et collaborateur de Trajan. Publius Helvius Pertinax, fils d’un affranchi, originaire d’Alba, devint sénateur, préfet de Rome, fut élu empereur par les prétoriens après Commode de janvier à mars 193 et assassiné. Beaucoup d’autres furent des personnalités de l’élite locale, remarquées par l’empereur pour leurs richesses et leur influence politique locale, comme le chevalier Caius Valerius Pansa à Novare, dont la femme Albucia fut une riche prêtresse qui laissa par testament une somme de 200.000 sesterces à la municipalité ; ou comme Caius Gavius Silvanus, centurion de Turin puis commandant de la garnison de Rome sous Néron, ou Caius Valerius Clemens, magistrat de Turin, qui fit partie de l’entourage de Vespasien. La mobilité sociale permettait aussi à de nombreux affranchis, souvent d’origine grecque ou syrienne, de prendre place dans les collèges sacerdotaux et dans les magistratures urbaines ; se joignaient à eux une importante classe moyenne composée de fonctionnaires locaux, de militaires de profession où se mêlaient les noms d’origine italique et d’origine indigène, ligure ou celte.
Dans les cultes religieux, les divinités romaines intégraient les anciens cultes aux divinités alpines ; on honorait les Matronae populaires dans toute l’aire gauloise, déesses de la fertilité, ou la déesse Victoria, protectrice celtique de la force pacifique, ou les dieux celtiques Belenos (dieu de lumière comparable à Apollon, protecteur de la médecine et des arts), Albiorix (appelé aussi Toutatis, assimilé à Mars), ou Cernunnos (dieu-cerf, de la fertilité et de la virilité). Le culte d’Isis eut un succès très grand, comme dans tout l’empire (elle donne son nom à un de ses lieux de culte proche de St Chamond, Izieux, et probablement à Izieu dans l’Isère) ; au Piémont, il était centré à Industria, grand lieu de pèlerinage visité même par les empereurs, jusqu’à l’arrivée d’un christianisme très intolérant qui détruisit le sanctuaire et ruina la ville. Isis était déesse-mère universelle, protectrice et salvatrice de la vie, assimilée souvent à Déméter, Perséphone, Diane.
La crise économique, politique, militaire des IIe et IIIe siècles, provoqua un déclin démographique, aggravé par de grandes épidémies de variole sous Marc-Aurèle, une expansion des « latifondi », grandes propriétés, et un déclin de la petite et moyenne propriété. L’empereur y répondit en envoyant des émissaires qui diminuèrent les pouvoirs des édiles locaux et les autonomies municipales, et en réorganisant l’administration impériale. Après Constantin, la capitale de l’empire d’Occident fut établie à Milan, et donc la résidence de l’empereur et de sa cour. Cela redonna vigueur à l’économie de la plaine du Pô, par la présence de nombreux régiments et par les commandes de la cour, en particulier pour les grands centres placés sur des circuits routiers, Turin, Vercelli, Ivrea, Tortona, Acqui, tandis que les centres plus éloignés se marginalisent et se dépeuplent dans le Piémont au sud du Pô.
Les cultes religieux venus d’Orient pénètrent en Piémont aux côtés des cultes romains et indigènes. Outre celui d’Isis, il y a celui du Soleil, le culte de Mithra, le culte orgiastique de la Magna Mater Cybèle, qui sont tous présents à Turin. La pénétration du christianisme est plus tardive : les premières stèles chrétiennes datent de 401 et de 432 à Acqui, de 434 à Tortona ; la pénétration se fit par les routes qui remontaient de la mer en Ligurie, portée par des fonctionnaires, militaires et négociants originaires de zones méditerranéennes plus tôt christianisées. Pourtant il est probable que des communautés existaient déjà depuis la moitié du IVe siècle ayant à leur tête un évêque résidant à Vercelli, – alors la ville la plus importante de la région –, et dont le premier fut Eusèbe, sarde formé à Rome qui arrive dans le Piémont entre 345 et 350. Il fut la plus grande personnalité du christianisme dans l’Italie du nord-ouest, et l’un de ceux qui luttèrent contre l’hérésie d’Arius condamné au Concile de Nicée en 325. Il y eut d’autres évêques, Innocenzo et Esuperanzio à Tortona, Massimo à Turin dont il fut le premier évêque qui organisa en 308 le concile des évêques italiques et gaulois, Gaudenzio à Novare, Eustazio à Aoste. Mais à partir de 374, ce fut le charisme d’Ambroise (340-397) qui focalisa la vie chrétienne autour de Milan, dont il fut évêque de 374 à sa mort.
Les évêques s’installent donc dans les villes qui sont, de cette époque à nos jours, les plus importantes de la région ; dans les autres, devenues parfois de simples villages, ne s’établit qu’une simple paroisse (la « pieve »), qui construit une église sur l’emplacement ou à côté des anciens sanctuaires païens. Les premiers convertis furent sans doute les grands propriétaires en contact avec la ville, tandis que les paysans pauvres continuaient à pratiquer les cultes païens et à ensevelir leurs morts dans les anciennes nécropoles, où subsistait même parfois la crémation païenne : la culture populaire se réfère pendant longtemps aux cultes antérieurs au christianisme.
Dans les villes, les évêques apparaissent vite comme des hommes de pouvoir en même temps que de foi : un évêque comme Massimo à Turin contrôle de façon très autoritaire tous les aspects de la vie de ses fidèles, de la famille à la vie économique. Ils tendent donc à se substituer aux autorités municipales ou impériales dans l’assistance aux pauvres comme dans le contrôle des temps liturgiques, la répression des fêtes païennes, l’imposition du calendrier chrétien qui structure le temps de cette population urbaine de fonctionnaires, militaires et propriétaires. Les autorités impériales ne tardèrent pas à déléguer aux évêques des responsabilités de gestion municipale, tandis que les grands « latifondisti » font pression pour faire élire des évêques qui leur soient favorables. L’évêque a pris ainsi un rôle mi-pastoral mi-politique.
Apparaissent aussi les premiers monastères, qui ne sont encore que les expériences de quelques individus ou petits groupes qui choisissent de vivre ensemble, parfois entre hommes et femmes, ce qui irritait les évêques. Sur un autre plan, Eusèbe lancera au Piémont le culte des martyrs et des reliques : reliques de saint Teonesto apportées de Palestine, pour qui on fonde une basilique ; les reliques de saint Jean-Baptiste sont depuis cette époque honorées en Piémont. Plusieurs évêques sont à leur tour sanctifiés, Eusèbe à Vercelli, Massimo à Turin, Gaudenzio à Novare, Jules près du lac d’Orta, Solutore, Avventore et Ottavio, martyrs turinois, soldats de la légionnaire légendaire Légion Thébaine, légion romaine sous Dioclétien, entre 285 et 306, qui, convertie sous la direction de saint Maurice, aurait été massacrée en 297 dans les Alpes pour avoir refusé de célébrer le culte de l’empereur ; mais c’est seulement à partir de Grégoire de Tours que l’on raconta cette invraisemblable histoire du massacre de 6666 légionnaires à une époque où les persécutions contre les Chrétiens ne touchaient guère que l’Orient. Mais on avait alors besoin de créer des reliques pour avoir dans l’au-delà quelques protecteurs.
3) Des invasions barbares à Charlemagne
Jusqu’à l’arrivée des « Longobardi », l’Italie impériale traverse une crise profonde : d’une part crise générale de l’empire, déclin du commerce, diminution de la circulation monétaire, manque d’investissements de la part du pouvoir central, division de l’empire entre Orient et Occident, jusqu’à la chute du dernier empereur d’Occident, Romulus Augustule en 476, déposé par Odoacre, chef des Hérules, qui gouverne la péninsule ; famines (en 411, 450), pestilences, destruction des troupeaux se succèdent ; d’autre part, les invasions barbares commencent en 376 avec le passage du Danube par les Goths, autorisé par l’empire : en 402, Alaric, assiège Milan puis Asti, et il est vaincu à Pollenzo ; en 406, un chef de guerre ostrogoth, pas encore converti au christianisme, passe le Mont Genèvre et saccage les campagnes jusqu’à sa défaite par le général Stilicon ; Ostrogoths, Burgondes, Vandales, Huns, Hérules, etc. se combattent en Italie, massacrent, pillent, ravagent, obligeant les paysans à émigrer vers les villes, et les propriétaires fonciers à s’enfermer dans leurs villas, protégés par des mercenaires. Les seuls à tenter de maintenir un relatif tissu social sont les évêques. Les cultures sont souvent abandonnées, les habitants quittent les villages pour constituer des « castrum » sur le haut des collines ; ils réoccupent même parfois les grottes ; le pays se dépeuple.
Théodoric (451-526) élimine Odoacre en 493 et devient roi d’Italie, « roi des Goths et des Romains », avec capitale à Ravenne ; sa domination accorde un dernier temps de répit à l’Italie du Nord, où les Goths installent des garnisons avec leurs familles (en particulier à Tortona qui prend une importance particulière). Combattu par les empereurs Justin et Justinien, et par le pape (Théodoric est resté arien), il ne parvient cependant pas à unifier l’Italie.
Pendant une vingtaine d‘années se poursuivit la guerre entre les empereurs byzantins et les Goths ; elle atteignit le Piémont en 537, date à laquelle le général byzantin Bélisaire put envoyer une armée dans la plaine du Pô ; les Goths s’étaient fortifiés à Pavie, et, aidés par une armée burgonde, purent résister à Bélisaire ; celui-ci fit une seconde tentative en 539, et s’installa à Tortona, mais les Goths et les Grecs furent chassés par une invasion triomphante des Francs qui avaient combattu la présence des Ostrogoths en Gaule, sous la direction de Clovis (466-511), et qui s’imposèrent dans la plaine du Pô jusqu’à l’arrivée des Longobards en 568, après le passage meurtrier de deux épidémies d’une peste nouvelle, la peste bubonique inguinale ou « peste de Justinien ».
Les Longobards étaient peu nombreux (de 100 à 200.000 personnes en tout), mais ils s’emparèrent des terres et du pouvoir ; ils s’installent en regroupements compacts qu’ils appelaient « fare » (Cf Fara Novarese, Fara, près de Novi Ligure) ; les toponymes en « -igi » révèlent aussi leur présence (Racconigi, Levaldigi, Scarnafigi) ; mais ils sont surtout repérables par leurs nécropoles où, encore païens, ils ensevelissaient leurs morts avec les objets (joyaux, armes …) qui avaient caractérisé leur vie et leur statut social (Voir les tombes de Testona, près de Moncalieri, aux portes de Turin ; tombes de Collegno, d’abord païennes puis chrétiennes vers l’église de San Massimo ; tombes de Turin, Vercelli, Cureggio près de Novare). Mais la population romaine continue en partie à vivre aux côtés des Longobards, les artisans continuent à travailler comme auparavant (par exemple la terre cuite vitrifiée des Romains), et les notables s’intègrent peu à peu dans la société longobarde.
Le Piémont fut important pour les Longobards, c’était un point chaud des frontières, du fait de l’hostilité des Francs qui souhaitaient garder le contrôle des vallées de passage (Suse, Aoste) et contre eux les Longobards fortifièrent les accès au Mont Genèvre, au Mont Cenis et au Grand et Petit-Saint-Bernard. Turin avait donc une importance stratégique essentielle, et un « duca » s’y installa dans l’ancien Forum romain (Place Palazzo di Città). Au Sud du Piémont, l’affrontement se fait avec les troupes impériales byzantines installées à Gênes. Trois autres « duchi » furent installés à Asti, Ivrea et San Giulio d’Orta ; plusieurs rois longobards furent choisis parmi ces « duchi » (Agilulf et Arioald de Turin, Aripert d’Asti). La capitale du royaume longobard était Pavie.
Après les violences et les destructions initiales, une paix relative se fit entre évêques ariens et évêques catholiques, et on connut une reprise du commerce, les Longobards battirent monnaie pour remplacer les monnaies byzantine et ostrogothe, dans trois Hôtels des monnaies à Ivrea, Pombia, au Nord de Novare, et Vercelli. Les Longobards se convertirent au catholicisme vers la fin du VIIe siècle. C’est à cette époque qu’apparaissent les premiers monastères : les petites abbayes de Villar San Costanzo, San Pietro di Pagno, Santa Giustina à Sezzadio, San Michele à Oleggio, ou les grands monastères de la plaine, San Colombano de Bobbio, San Salvatore de Brescia, la Novalesa, fondée en 726. En fin de royaume, l’assimilation était complète aux lois et coutumes des Longobards : protection juridique de la femme par un de ses proches parents, donation du mari à la femme après consommation du mariage, dot à la fille qui se mariait ; le droit romain s’était effacé devant le droit longobard, considéré comme plus avancé, et les magistrats étaient longobards. Mais les Longobards, convertis au catholicisme, avaient renoncé à leur mode de sépulture, et leur langue germanique avait été remplacée par le latin dialectal parlé dans la région, d’où naîtront les langues et dialectes romans.
Les Longobards, originaires d’Allemagne orientale et du Sud de la Scandinavie, émigrèrent vers le Sud et s’installèrent en 568 en Italie où ils créèrent un royaume divisé en « duchés » ; la capitale était Pavie ; ils s’étendirent à une bonne partie de l’Italie et leur royaume fut un des plus grands entre les VIIe et VIIIe siècles. Paolo Diacono (720-799) dit que leur nom signifie dans leur langue « qui a une longue barbe » ; mais on l’explique maintenant comme « ceux qui ont une longue lance ». À cette époque, les Longobards étaient encore ariens.
C’est Didier qui devint roi en 756, et maria une de ses filles à Charlemagne qui prit le pouvoir en 771 chez les Francs et, allié au nouveau pape Adrien I, renversa en 773 le roi Didier dont il avait répudié la fille, et prit le titre de « Roi des Francs et des Longobards ». Seul resta longobard le duché de Benevento jusqu’en 1053.
Charlemagne n’abolit pas le royaume longobard qui continua à fonctionner de façon semi autonome jusqu’en 888, date de la mort de Charles le Gros, dernier descendant direct de Charlemagne. Les lois longobardes restèrent en vigueur, mais Charlemagne réorganisa le territoire dans le cadre de l’empire, et aux circonscriptions lombardes (les « duchés ») succédèrent des districts plus petits et plus nombreux, quinze dans le Piémont., dirigés par des comtes parfois responsables de plusieurs districts. Charlemagne nomma des administrateurs et des fonctionnaires francs qui transmettaient dans tous les domaines les lois impériales. Cela modifia le substrat ethnique du Piémont et introduisit de nouveaux modes de fonctionnement et de nouveaux rapports sociaux dans la région. La grande propriété longobarde, les grands domaines appelés « curtes » se multiplièrent, gérés par des administrateurs dépendants de l’empereur, grandes forêts, qui servaient de chasses impériales, ou grands centres agricoles. Beaucoup de ces « curtes » qui regroupaient tous les paysans, esclaves ou libres, furent à l’origine des communes actuelles qui devinrent parfois des villes, comme Biella, Saluzzo ou Pinerolo.
À côté des « curtes », le pouvoir carolingien avait aussi développé la grande propriété ecclésiastique ou laïque, par des donations aux églises et monastères et des « bénéfices » aux fonctionnaires et fidèles de l’Empire. Dans toutes, esclaves et paysans libres se confondirent peu à peu dans un système nouveau, le servage, dont les propriétaires exerçaient aussi la justice et percevaient les impôts. Les rapports sociaux hérités de l’Antiquité disparaissent en même temps que les notions d’esclave, d’affranchi et d’homme libre : tous dépendent maintenant d’un seul maître protecteur auquel ils sont asservis. Ainsi se crée une classe de puissants qui disposent de la propriété foncière, des charges publiques, de clientèles souvent armées ; et l’ensemble de cette organisation est rendu cohérent par le système du vasselage et le serment de fidélité exigé du vassal vis à vis de son supérieur, dans une aristocratie militaire et ecclésiastique qui constituera le système féodal.
La croissance économique va de pair avec la croissance des villes, par les marchands et négociants, la croissance culturelle par l’institution de pôles scolaires pour la formation des cadres, à Pavie, Ivrea, Turin, etc. Le pouvoir carolingien réorganise aussi les paroisses, les « pievi », églises « baptismales », dont chacune est dirigée par un archiprêtre ayant autorité sur le clergé des églises non « baptismales » et chargé de recouvrer les dîmes payées par les paysans ; ces églises « baptismales » sont à la tête de ce qui deviendra les diocèses, titulaires de revenus qui suscitent les envies et les concurrences, même de la part des laïcs qui vont en faire leur point de rassemblement dans le désordre qui suivra la paix carolingienne.



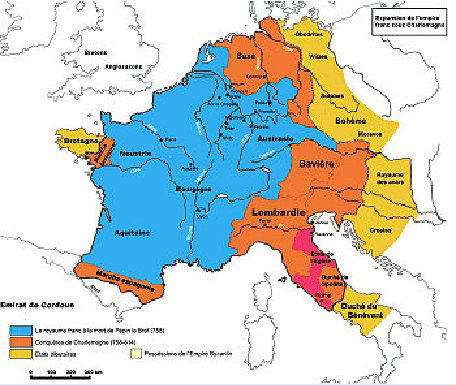
Leur roi était alors Alboin, assassiné en 572 par sa femme Rosmunda (Voir ci-contre tableau de Charles Lanseer, 1856) ; lui succède Clefi, que les Byzantins font tuer en 574. Autari est élu roi en 584 ; il épouse la princesse Teodolinda en 590, année de sa mort ; il est remplacé par Agilulf, « duc » de Turin, qui se définit « Roi d’Italie » et non plus seulement « roi des Longobards », et qui s’oriente vers la conversion au catholicisme. Agilulf meurt en 616, remplacé par son fils Adaloald sous la régence de Teodolinda. Arioald le détrôna en 625. En 636 lui succède Rotari, arien, duc de Brescia qui règne jusqu’en 652. Roi de 653 à 661, Ariperto pratique une répression féroce contre les ariens. Puis vinrent Grimoald (661-671) et d’autres rois qui divisèrent souvent le royaume, jusqu’à Liutprand (712-744) qui porta le royaume à son plus grand éclat ; il s’allia avec les Francs et les Avares, fit au pape une « donation » (Sutri), qui fut un antécédent à l’attribution d’un pouvoir temporel. Astolfe lui succède et achève la presque totale conquête de l’Italie (Voir carte), ce qui inquiéta le pape qui fit appel à Charles Martel qui contraignit les Longobards à se retirer.

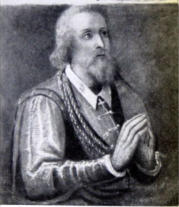

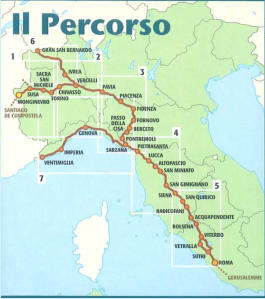
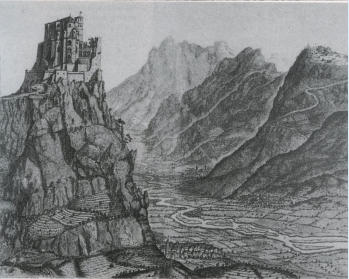

4) Autour de l’An Mille. L’arrivée de la famille de Savoie au Piémont.
Après la mort de Charles le Gros en 888, l’empire carolingien se décompose, à la fois pour des problèmes intérieurs et à cause des invasions hongroises et sarrasines. Les Hongrois étaient des « barbares » païens venus des plaines du Danube, éleveurs nomades qui faisaient des razzias de femmes, de joyaux d’églises et de bétail ; ils arrivent à Pavie en 899, puis dévastent la plaine du Pô jusqu’en 900 ; ils continuèrent à traverser la plaine du Pô jusqu’en 954, dévastant Pavie, Turin, Vercelli, et ils ne furent éliminés qu’en 954 par Othon I. Les Sarrasins avaient leur base à Frassineto (La Garde Freinet, près de St Tropez) en Provence, d’où ils contrôlaient les passages alpins ; ils effrayaient les Piémontais qui les évoquent souvent dans leurs légendes (voir la légende de la belle Aude à la Sacra di San Michele et le succès de la Chanson de Roland en Italie). C’étaient peut-être simplement des Hispaniques ou des bandits locaux, des paysans rebelles, mais quoi qu’ils fussent, ils saccagèrent les Alpes, l’abbaye de la Novalesa (au nord de Suse sur la route du Mont-Cenisne, fut homme de confiance d’Henri III, Grégoire, évêque de Vercelli, excommunié pour son concubinage avec une veuve), Asti, Alba jusqu’à la destruction de Frassineto en 972.
D’autre part, tous les grands feudataires de l’empire ambitionnèrent de s’approprier les titres et les territoires de Charles le Gros ; parmi ceux-ci, le marquis du Frioul, Berengario (850-924), se fit élire comme successeur de Charles le Gros, en rivalité avec Guido da Spoleto, avec l’empereur Ludovic de Provence et avec Rodolfo, roi de Bourgogne ; il triompha grâce à l’appui des troupes hongroises, mais fut assassiné par les feudataires en 924 à Vérone ; la plupart des luttes de ces candidats au trône d’Italie se déroulèrent dans la plaine du Pô, la capitale du Royaume étant toujours Pavie. Après lui, le titre de rois d’Italie fut accordé à divers marquis, jusqu’en 963, date à laquelle il devient propriété de l’empereur du Saint Empire Romain Germanique, dont le dernier fut Charles Quint de Habsbourg, mort en 1556, mais leur domination resta souvent toute théorique.
Cette dislocation de l’empire carolingien laissa place dans le Piémont aux « marquis » qui constituèrent peu à peu des « marches » indépendantes et qui furent ensuite à l’origine de dynasties. Il y en eut quatre principales, le Franc Anscario à Ivrea, le Franc Ardoino à Asti et Ventimiglia, dont la famille s’unit ensuite à celle des Savoie, un autre Franc, Aleramo, du Montferrat à Savona, à l’origine du marquisat de Saluzzo, et un Longobard, de Gênes à Tortona, Oberto qui fut parmi les ancêtres des Este et des Malaspina ; ces trois dynasties, les Savoie, les Monferrat et les Saluzzo jouèrent un rôle décisif dans la création du Piémont moderne. Ces nobles entretenaient des familles de fonctionnaires fidèles, clients qui jouissaient d’une partie du patrimoine et furent la base de la hiérarchie féodale de la région.
Dans ce contexte de faiblesse du pouvoir central, un autre pouvoir se renforce, celui des évêques, qui s’affirment sur le plan politique, sur la base de leur prestige spirituel, de leur immense patrimoine foncier (les monastères qu’ils géraient) et des ressources des villes où ils exerçaient. Les empereurs étaient soucieux de contrôler ces pouvoirs et ils faisaient nommer comme évêques des hommes à eux : Ludovic le Pieux imposa à Turin l’espagnol Claude, malgré ses opinions théologiques (il est souvent considéré comme un ancêtre des Vaudois …) ; Charles le Gros fit élire comme évêque de Vercelli son principal conseiller Liutward, et son frère Cadolt à l’évêché de Novare. Pour s’en faire des alliés, les candidats à l’empire et au royaume d’Italie donnaient même aux évêques le pouvoir judiciaire, politique et économique (les impôts !) : l’empereur Othon I (962-973) favorisa même le pouvoir des évêques pour contrebalancer celui des marquis qui prenaient trop d’indépendance ; ayant la faveur de l’empereur, les évêques n’hésitaient pas à s’opposer aux pouvoirs laïques et à agrandir leurs domaines à leurs dépens, obtenant ainsi toujours plus de terres et de pouvoir : Léon, évêque de Vercelli obtint d’Othon III en 999 tout le « comté » de Vercelli et celui de Santhià ; Pierre, évêque de Novare, reçoit d’Henri III le « comté » d’Ossola (1014) et de Conrad II celui de Pombia (1025) ; Oddon, évêque d’Asti obtient d’Henri IV la totalité du « comté » d’Asti en 1093. Se créent ainsi des « seigneuries épiscopales ». Les luttes entre évêques et vassaux laïques furent souvent d’une violence militaire terrible, comme celle qui opposa Léon de Vercelli à Ardoin, titulaire de la marche d’Ivrea. En 1037, l’empereur Conrad II dut intervenir et il garantit à ses vassaux de droit de laisser leurs bénéfices en héritage à leurs enfants.
L’affaiblissement du marquisat de Turin en 1091 (voir plus loin) permit aux évêques d’augmenter encore leur pouvoir et fortifier leur patrimoine foncier, par la fondation de monastères qu’ils contrôlaient et par la concession par l’empereur de « comtés » entiers comme celui d’Asti à l’évêque Oddone en 1093 par l’empereur Henri IV. Par ailleurs la réforme radicale proposée par le pape Grégoire VII rencontra l’hostilité des évêques piémontais, en particulier l’interdiction d’acheter des charges ecclésiastiques en argent comptant et l’interdiction du mariage des prêtres et des évêques : améliorer le niveau culturel des prêtres, oui, mais leur interdire de prendre femme, non ! D’autant plus que le peuple prenait parti contre les évêques mariés et souvent corrompus et simoniaques (cf. mouvement des Patarins, et plus tard des « Pauvres de Lombardie »). Or c’était la période de la querelle entre le pape et l’empereur sur les investitures : l’empereur souhaitait nommer lui-même les évêques ; les évêques piémontais prirent alors souvent le parti de l’empereur contre le pape ; ils étaient d’ailleurs souvent conseillers de l’empereur et occupaient de hautes charges à la cour : l’évêque de Turin, Landolfo, avait été chapelain d’Henri II, celui de Novare, Oddone, fut chancelier d’Henri IV ; à Asti, la comtesse Adélaïde fit nommer un évêque partisan de l’Empire, ce qui provoqua une révolte populaire durement réprimée. Pour ces évêques, les propos réformateurs du pape brisaient avec les traditions ecclésiales et introduisaient le désordre. Ces conflits entre les pouvoirs contribuèrent à la désagrégation du système carolingien des « marches » et ouvrirent la place à une forme politique nouvelle, celle des « communes » libres.
Le Xe siècle fut pourtant le début d’une reprise économique du Piémont, la population paysanne augmente, la surface des forêts de plaine diminue, et les terrains sont défrichés à coups de serpe et mis en culture, les marquis ou les évêques créent des foires et des marchés, et font construire des villages fortifiés pour protéger les habitants et les églises (les « castra » entourés de palissades ou de murs en pierre, appelés « castelli », châteaux) : dans le diocèse d’Asti, il y a 8 châteaux à la fin du Xe siècle, 16 de plus entre 950 et 1000 et 47 autres au XIe siècle ; l’évêque d’Asti était propriétaire de 30 châteaux. La population paysanne se concentre de plus en plus dans ces « châteaux » qui donneront souvent naissance aux futures communes, même si l’habitat paysan reste encore éparpillé en groupes de cabanes ou en cabanes isolées, mais contrôlées par le pouvoir des « curtes » qui leur donnait refuge en cas de danger mais qui exigeait soumission, contribution en argent et fourniture de travail gratuit. On tend ainsi peu à peu vers un régime social nouveau, la « seigneurie ». Parmi les familles qui s’imposèrent dans cette évolution, il faut citer celle des « Aleramici », les descendants d’Aleramo, marquis de Monferrato et de Saluzzo, et surtout celle des « Arduinici », descendants d’Arduino le Glabre dont le fils, le marquis Olderico Manfredi obtint sa seigneurie de Turin en possession héréditaire de la part de l’empereur Othon III. À sa mort en 1034, il transmit son bien à sa fille Adélaïde (1016-1091), comtesse de Turin et de Suse (seuls les hommes pouvaient porter le titre de marquis), qui eut un rôle central dans la gestion du Piémont pendant un demi-siècle, une des femmes politiques les plus importantes du XIe siècle italien avec Mathilde de Canossa. Elle avait marié sa fille Berthe à l’empereur Henri IV qu’elle soutint toujours dans ses luttes contre le pape, elle était présente à l’entrevue de Canossa ; elle se maria trois fois, et son dernier mari fut Othon (Oddone) (1023-1060), fils du comte de Savoie Umberto Biancamano, et comte d’Aoste et de Maurienne, qui s’était créé un grand domaine au-delà des Alpes, de Lyon à la vallée d’Aoste. C’est ce mariage qui fit entrer les Savoie dans l’histoire du Piémont.
La force d’Oddone réside dans le contrôle des cols alpins (Mont Genèvre, Mont Cenis, Petit et Grand Saint Bernard) , qui commandent les routes de l’Europe du Nord à l’Italie et à Rome, pour les marchands, les pèlerins, les armées féodales : « Contrôler ces cols, où passent les marchandises précieuses d’Orient et les dîmes pour l’Église de Rome, signifie contrôler les trafics d’Europe ; on peut accumuler de la richesse en imposant des péages pour le transit, en gérant des hospices, en offrant des services aux voyageurs ; mais surtout on peut prendre une initiative politique et diplomatique en favorisant le passage de l’une ou de l’autre armée, en s’alliant avec un puissant ou avec l’autre (et en en recevant la gratitude en termes de nouvelles possessions féodales) » (Gianni Oliva, I Savoia, Oscar Storia Mondadori, 2007, p. 37). Durant la guerre pour la succession au trône de Bourgogne, Oddone avait soutenu l’empereur Conrad II, qui avait besoin de fidèles pour garder les grandes voies de communication. À la mort d’Adélaïde, son héritier, son petit-fils Humbert II perdit une partie de la Marche de Turin, mais il acquit la vallée de Suse, c’est-à-dire le contrôle de la « Via Francigena », une des plus importantes voies de communication européennes, « via Romea », route des pèlerins de Cantorbéry à Rome, ou de St Jacques de Compostelle à Rome (Cf. cartes ci-dessus et page suivante).
5)Des Seigneuries aux Communes. La prospérité médiévale
Le Moyen-âge apparaît comme une période de plus grande prospérité : ce fut une période de climat plus doux même dans les zones alpines, les investissements prospérèrent, l’optimisme augmenta, et les monastères défrichèrent de grands espaces des forêts de plaine pour installer des pâturages, par exemple les abbayes de Santa Maria di Lucedio (d’immenses domaines créés au XIIe siècle par les cisterciens de Chalons sur Saône au nord D’Asti) et de Staffarda (fondée en 1140 au sud de Cavour par les cisterciens).
De plus en plus, évêques et propriétaires autorisèrent leurs paysans à déboiser et à bonifier la terre pour planter des céréales, nécessaires pour nourrir une population en augmentation, des châtaigneraies (qui remplaçaient les bois sauvages de chênes où paissaient les porcs par une forêt « domestique » destinée à l’alimentation des hommes) ; les porcs étaient remplacés par de l’élevage ovin. La charrue tirée par des bœufs avait acquis le soc métallique (la « slòira ») qui permettait de creuser plus profond un sol où alternaient le blé et le seigle semés en automne et l’avoine, le millet, le sorgo semés au printemps. L’irrigation se développait (les fossés appelés « rogge »), le paysage se remplit de moulins avec leur roue en bois. Et puis les puissants, évêques, moines ou princes, s’occupaient moins de l’agriculture, tirant plus d’argent des impôts et des péages ; l’esclavage fut à peu près liquidé au profit d’une forme nouvelle de métayage qui laissait les paysans plus libres et conscients de l’être. Les monastères développèrent la transhumance de leurs troupeaux de porcs et de moutons vers leurs domaines alpins, fournissant des péages énormes aux possesseurs de terres, comme le comte de Savoie (par exemple à Rivoli passaient chaque année 25.000 moutons).
La population rurale se répartit de façon inégale, mais, pour des raisons de sécurité, se regroupe autour du « château » ou de la « villa », dans des bourgs ou villages : les paysans se pensent de plus en plus comme une communauté, en particulier pour les négociations avec le seigneur pour la location de la terre ; le nombre de villages se réduit donc, tandis que se créent des villages nouveaux autour d’un monastère (Borgo San Dalmazzo, Villar San Costanzo) ou d’une forteresse de colline (Cf les noms en « Rocca » : Roccasparviere, Roccavione) ; à peu de choses près, la campagne prend l’aspect qu’elle a encore aujourd’hui. Ce qui domine tout cela, c’est d’abord la « seigneurie » locale, le seigneur qui tente de « protéger » les paysans, prince, évêque, chanoine, homme d’affaires, monastère. Se crée ainsi un rapport conflictuel entre le seigneur (le « dominus ») qui veut faire fructifier sa terre et la communauté paysanne qui cherche à alléger sa soumission : paiement de la taille, amendes pour les transgressions, travail gratuit (la « roida »), l’obligation de loger le seigneur, ses hommes et sa cour, le droit pour le seigneur de reprendre le bien de qui meurt sans héritier, la taxe à verser pour utiliser les pâturages, les bois, les eaux, tous droits qui existent jusqu’à la Révolution française. Le seigneur a en effet repris l’ancien droit royal de punir et de contraindre, à travers la violence et le serment de fidélité.
La vie se déroule donc dans une permanence de conflits, souvent armés, entre seigneurs voisins, pour le contrôle des terres louées aux paysans, pour savoir à qui seraient payées les taxes. Cela conduisit à marquer de façon toujours plus visible (fossé, croix, etc.) les limites de territoire de chacun, donnant ainsi forme aux futurs territoires des communes. C’est donc une aristocratie militaire qui prend le pouvoir dans la société, formant une ensemble de familles, selon le droit franc, lombard ou romain qui ne prévoient pas le droit du premier né mais la subdivision de l’héritage et donc la nécessité de se regrouper en « condomini » qui mettent en commun leurs propriétés ; certaines familles deviendront ainsi dominantes dans le Piémont : Morozzo della Rocca, Luserna di Rorà, Valperga di Caluso, San Martino d’Aglié, Radicati di Brozolo.
Au-dessus de ce grouillement de familles nobles locales, quelques nobles ont une importance supérieure, les marquis de Montferrato, les marquis de Saluzzo, les comtes de Savoie et les comtes de Biandrate, qui influencent la politique des grands, empereurs ou papes, avec lesquels ils s’unissent par mariages de leurs enfants. Ils devaient cependant défendre leurs terres, dont ils risquaient toujours de perdre le contrôle, et garder la fidélité de leurs paysans et sujets en jouant de la contrainte et des concessions. Disposant au départ de terres souvent dispersées, ils tendent à se créer des domaines toujours plus unifiés.
Parmi les puissants du Piémont figuraient les monastères. Ce furent d’abord les moines « noirs », les Bénédictins, peu à peu concurrencés par l’arrivée des moines « blancs », Cisterciens et Chartreux. nés en France, en Bourgogne (Cîteaux) pour les premiers, en Dauphiné (Grande Chartreuse) pour les seconds, qui s’étendent d’abord en Piémont avant toute autre région d’Italie ; ils sont appuyés par les princes les plus forts de la plaine et des montagnes ; signe d’une grande ferveur religieuse, l’installation de ces deux ordres ne va pas sans opposition : ils transforment considérablement le paysage des campagnes en déboisant et en occupant les terrains incultes, faisant perdre aux paysans leurs droits de chasse et de ramassage du bois. Ils sont cependant très appréciés et utilisés par les princes dont ils facilitent les rapports avec l’empereur et surtout le pape.
Par contre une réalité nouvelle s’oppose au pouvoir des princes, celle des communes urbaines, qui se créèrent aussi en Piémont, même si finalement les dynasties princières se révélèrent plus résistantes. L’expérience communale se développa dans les plus grandes villes, de 10.000 à 15.000 habitants, comme Vercelli, Asti, Chieri et Alessandria (créée en 1168), mais aussi dans des villes de 5.000 habitants, parfois anciens centres épiscopaux, comme Turin, Ivrea, Novara, Alba, Acqui Terme, Tortona, Pinerolo, Moncalieri, Casale, Biella, Chivasso, ou villes nouvelles comme Cuneo, Mondovì, Fossano, Cherasco, Savigliano. Les communes favorisent l’immigration des paysans et artisans désireux de trouver du travail et d’échapper à la soumission aux seigneurs, en leur octroyant un droit de citoyenneté et une exemption d’impôts pendant plusieurs années. Les villes grandissent, il faut élargir les enceintes, construire de nouvelles maisons plus adaptées, ayant plusieurs étages, tandis que les nobles immigrés se font construire des maisons fortes surmontées de tours. Les boutiques d’artisans se multiplient, en même temps que les foires et les marchés ; les industries s’installent le long des fleuves, moulins, tanneurs, foulons ; les chantiers se développent pour la construction des églises (Vercelli, première église gothique d’Italie, en 1219) ; les marchands s’organisent en associations ; souvent les villes obtiennent de l’empereur le droit de battre monnaie (Asti dès 1140, qui vit du commerce de l’argent par ses banques installées dans une partie de l’Europe).
Cette poussée des communes se traduit par une participation plus large de la population à la gestion de la ville, jusqu’alors dirigée par l’évêque : on élit des consuls qui agissent au nom de la collectivité, en 1095 à Asti, Tortona en 1122, Novara en 1139, Vercelli en 1141, Turin en 1147. Ainsi s’établissent des rapports parfois violents entre une population qui s’émancipe, l’évêque et le comte ou marquis local, formant des alliances changeantes selon les nécessités du moment (conflits d’Asti, de Turin, de Vercelli). Ce qui est nouveau, c’est la conscience qu’a le « peuple » d’avoir des intérêts collectifs et de constituer une communauté unie (le terme de « commune » apparaît pour la première fois à Vercelli en 1148). Bientôt les consuls commenceront à devenir « judices » et à rendre la justice, dès 1161 à Asti, 1170 à Tortona, 1178 à Vercelli ; à partir de ce moment-là, les évêques perdent le contrôle des péages et des impôts sur les marchés, souvent à contrecoeur ; la juridiction épiscopale finira par disparaître totalement, à Tortona en 1234, Vercelli en 1243, et sera remplacée par une nouvelle juridiction. Les consuls finiront par constituer une nouvelle oligarchie, une aristocratie consulaire (80 familles à Asti, 70 à Vercelli) qui est composée de « milites », chevaliers qui forment le cœur des armées communales : les communes ne sont pas créées seulement par une nouvelle bourgeoisie mais aussi par une aristocratie militaire capable d’assurer la direction politique des masses urbaines et rurales ; ils se font même souvent élire au chapitre de la cathédrale ou au poste d’évêque qui est au cœur d’un comité d’affaires qui dirige la vie de la commune et la vie de l’Église, s’appropriant des rentes, des terres et des châteaux (l’évêque Gisulfo Avogadro à Vercelli, de 1131 à 1151, puis l’évêque Guala Bondoni de 1170 à 1182). Ces trafiquants enrichis par le commerce et l’usure deviennent les familles les plus illustres des villes piémontaises de l’Ancien Régime.
Lorsque Frédéric Barberousse (1122-1190)) fut élu empereur en 1152, les villes piémontaises se trouvèrent face à un projet de consolidation du pouvoir monarchique et de constitution d’un empire universel qui impliquait la soumission de l’Italie du Nord et du Royaume de Sicile ; elles durent prendre position, car cela mettait en cause l’autonomie communale qui commençait à se développer. Les villes où le pouvoir communal était le moins évolué se soumirent à l’empereur et appuyèrent sa lutte contre Milan, sous la direction de l’évêque à qui l’empereur donna plus de pouvoir sur leur district : Vercelli, Turin et l’évêque Carlo qui accueillent l’empereur en 1159, Novare qui participe à la destruction de Milan en 1162. Le marquis de Montferrat était le principal point d’appui de l’empereur ; Milan, en lutte d’influence avec Lodi, Côme et Pavie était le centre de la lutte anti-impériale. D’autres villes, en conflit avec leur évêque et hostiles au marquis de Montferrat, résistèrent à l’avancée impériale : Asti, Chieri, Tortona (en lutte contre Pavie qui soutenait l’empereur), Chieri est assiégée et détruite par Frédéric Barberousse en 1154, Asti en 1155, Tortona fut incendiée en 1155 et en 1163.
Mais bientôt, les communes se renforcèrent et en 1167, même Vercelli, Asti et Novare adhérèrent à la Ligue lombarde constituée le 7 avril 1167 à l’abbaye de Pontida, renforcée le 1er décembre et appuyée par le pape Alexandre III, en l’honneur de qui on nomma « Alexandrie (Alessandria) » la nouvelle ville et forteresse construite contre l’empereur aux confins du marquisat de Montferrat. Descendu en Italie en 1158 et 1166, puis en 1174, l’empereur fut vaincu par les troupes communales le 29 mai 1176 et dut accepter la trêve de 1177 et le Traité de Constance en 1183, par lequel les communes restaient fidèles à l’empereur, à condition que celui-ci leur reconnaisse une pleine autonomie juridictionnelle. Novare et Vercelli avaient signé le Traité du côté de la Ligue, Asti du côté de l’empereur avant de rétablir son alliance avec Milan. Les marquis de Montferrat et de Saluzzo tentèrent encore de reprendre la lutte contre les communes de 1190 à 1206, mais durent renoncer et se retournèrent vers l’Orient en participant aux croisades où ils se marièrent avec des princesses byzantines et moururent, signant ainsi la fin des dominations princières en Piémont. La crise des deux marquisats laissa une place plus grande aux comtes de Savoie, qui durent cependant négocier avec les communes de Turin et D’Asti.
La lutte entre les communes et l’empereur continua sous Frédéric II de Hohenstaufen (1194-1250), la Ligue lombarde se reconstitua en 1226, et obtint finalement la victoire en 1238, en particulier grâce à la victoire de l’armée de Bologne sur celle de Modena. La Ligue se dissout en 1250 à la mort de Frédéric II. Ce fut le moment où se constituèrent en Italie les deux partis opposés, « parti de l’Église » (les Guelfes) et « parti de l’empire » (les Gibelins), auxquels les communes adhèrent moins par idéologie que par des intérêts qui peuvent les faire passer de l’un à l’autre ; à l’intérieur même de chaque commune, les familles nobles se rattachaient à un parti ou à l’autre en fonction de leurs intérêts dans la ville : à Vercelli, les Bicchieri et les Bondoni favorables à l’empire contre les Avogadro et les forces populaires qui s‘appuient donc sur l’évêque et le pape.
Outre les pressions qu’elles exerçaient sur les châteaux pour qu’ils leur cèdent leurs droits, les communes construisirent des villes nouvelles qui limitaient encore plus les pouvoirs des princes ou des évêques. Ainsi en 1167, les habitants de 8 localités dépendant du marquisat de Monferrat décidèrent de quitter leurs villages et de fonder un bourg nouveau qu’ils appelèrent « Alessandria » en l’honneur du pape Alexandre III ; pour affaiblir Monferrat, Gênes et Rome approuvèrent et le pape y instaura un siège épiscopal, malgré l’opposition des autres évêques locaux. De même Cuneo fut fondée en 1198 contre le marquisat de Saluzzo, et il lui fallut attendre 1231 pour atteindre sa pleine autonomie. Mondovì est fondée à la fin du XIIe siècle par les habitants de Vico et d’autres villages, et dut se battre contre l’évêque jusqu’en 1233 pour obtenir son autonomie grâce à l’appui de la Ligue Lombarde ; il en fut de même de Savigliano, créée par des paysans et des chevaliers ; Fossano est fondée en 1236 par les communautés de 4 localités ; Moncalieri est créée par les habitants de Testona qui abandonnent leur village en 1196 pour se mettre sous la protection d’une maison des Templiers. Mais beaucoup de villages nouveaux, des « bourgs francs », furent fondés par les chevaliers et les paysans d’une ville pour affaiblir un prince rural concurrent ou pour fortifier une voie d’accès à leur territoire : c’est le cas d’Asti, de Chieri, de Novara, de Mondovì, d’Alessandria et de Tortona ; beaucoup de nouveaux paysans venaient y habiter pour échapper à la domination d’un seigneur ; ainsi le territoire piémontais est-il remodelé par l’action des hommes. Même le comte de Savoie crée en 1139 le village d’Avigliana sur la route qui débouche du Val de Suse, grand passage de marchands.
Cette évolution poussa les paysans à s’organiser et à défendre leurs intérêts en négociant avec leur seigneur et en nommant des consuls pour les représenter, demander des franchises, limiter les droits des seigneurs (contributions, amendes, etc.) ; parfois même le seigneur est contraint de s’intégrer dans la communauté villageoise en se faisant élire « podestat » (maire du village). En somme, les communautés rurales, comportant un grand nombre d’habitants, imitaient les communautés urbaines, parfois peu importantes, créant une même culture politique centrée sur l’organisation communale et sur la défense des libertés et des intérêts communs. Les communes commencent à s’organiser de façon nouvelle, créant des conseils communaux (« consiglio di credenza »), à la tête desquels on nomme un podestat, généralement chevalier et expert de droit, pris dans une autre ville pour qu’il soit moins soumis aux luttes entre les factions locales ; se constituent aussi des « società di popolo », souvent consacrées au saint patron qui constituent un mode de participation large de la population à la vie de la commune, et la base d’une organisation populaire d’autodéfense armée, qui excluait les familles les plus importantes, lesquelles à leur tour constituaient des « societates militum » des plus riches marchands ou chevaliers. Au Piémont, les sociétés populaires s’intégraient avec les organismes professionnels, les corporations d’artisans, comme à Novara, Vercelli, Asti, Turin, Tortona. Certes, les familles les plus nobles et les plus riches devenaient souvent hégémoniques dans les organisations populaires et les manipulaient, mais il n’en reste pas moins que ces structures communales constituaient des expériences de gouvernement « démocratique » plus avancé.
Les comtes de Savoie
* v. 1027-v. 1047 : Humbert Ier Humbert aux Blanches Mains (v. 980-v. 1048), tige de la Maison de Savoie
* v. 1047-v. 1051 : Amédée Ier, fils du précédent
* v. 1051-v. 1060 : Othon Ier, frère du précédent. Il épouse Adélaïde, comtesse de Turin.
* v. 1060-v. 1078 : Pierre Ier, fils du précédent
* v. 1078-1094 : Amédée II (v. 1048-1094), frère du précédent
* 1094-1103 : Humbert II (mort en 1103), fils du précédent
* 1103-1149 : Amédée III (v. 1095-30 août 1149), fils du précédent, mort lors de la troisième croisade
*1149-1189 : Humbert III (1136-1189), fils du précédent
* 1189-1233 : Thomas Ier (v. 1177-1233), fils du précédent
* 1233-1253 : Amédée IV (1197-1253), fils du précédent
* 1253-1263 : Boniface le Roland (1244-1263), fils du précédent
* 1263-1268 : Pierre II (v. 1203-1268), oncle du précédent
* 1268-1285 : Philippe Ier (1207-1285), frère du précédent
* 1285-1323 : Amédée V le Grand (v. 1249-1323), neveu du précédent
* 1323-1329 : Édouard le Libéral (1284-1329), fils du précédent
* 1329-1343 : Aymon le Pacifique (1291-1343), frère du précédent
* 1343-1383 : Amédée VI le Comte vert (1334- 1383), fils du précédent
* 1383-1391 : Amédée VII le Comte rouge (1360-1391), fils du précédent
* 1391-1416 : Amédée VIII le Pacifique (1383- 1451), fils du précédent





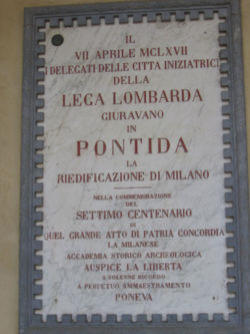









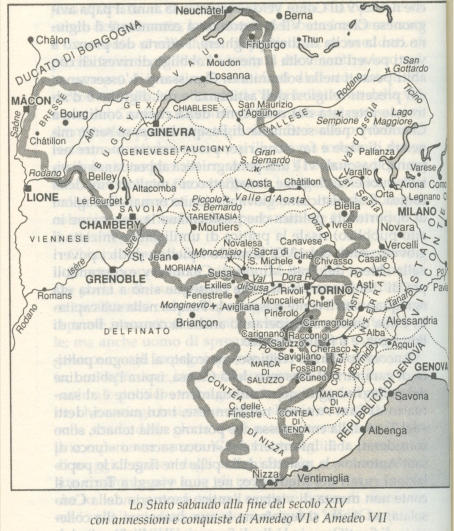
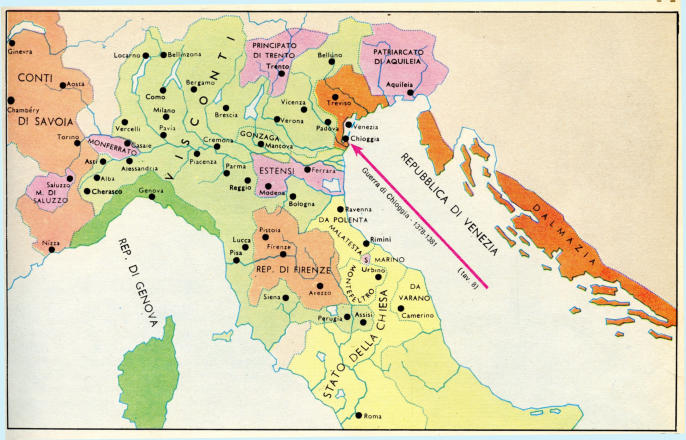

L’Italie est alors divisée entre plusieurs États : au sud, le Royaume de Naples (qui comprend la Sicile jusqu’en 1282, date des Vêpres siciliennes), occupé dès 1264 par le Français Charles d’Anjou, jusqu’en 1442 où le Royaume passe à la famille d’Aragon. Au centre, les États de l’Église qui remontent jusqu’à Ravenne, et les Républiques de Florence, Sienne, Lucques et Pise. Au nord, les Este à Ferrare, les Scaliger à Vérone, la République de Venise, le Principat de Trento et le Patriarcat d’Aquileia, le Duché de Milan (Visconti), la République de Gênes. Le Piémont est divisé entre les marquisats de Saluzzo et de Montferrat et le comté de Savoie.
Le territoire se partage bientôt entre quatre principaux acteurs : la famille d’Anjou, qui détiendra le Royaume de Naples jusqu’en 1442 et qui possédait quelques territoires en Piémont, doit abandonner Asti au marquis de Montferrat en 1345 et céder ses autres possessions (Cuneo) à Amédée VI de Savoie en 1382. Le principat d’Acaia est réabsorbé dans le comté de Savoie en 1418. Il ne reste donc que le duché de Milan qui domine l’est du Piémont (Novare, Vercelli, Alessandria, Tortona, et parfois Alba, Cuneo Asti et Mondovì) ; la frontière entre Milan et les Savoie s’établira sur le fleuve Sesia, qui reste la frontière linguistique entre les deux États, sous la pression des armées milanaises commandées par le condottiere Bartolomeo Colleoni (1395-1475). Les marquis de Montferrat (la famille des Aleramici de 967 à 1306, puis les Paléologues de 1306 à 1533, suivis par les Gonzaga de 1536 à 1708) ne résistent à leurs adversaires qu’en devenant « capitani di ventura » (chefs de guerre) au service des puissances voisines, jusqu’à l’annexion par les Savoie en 1708. Le marquisat de Saluzzo, après diverses vicissitudes, fut définitivement absorbé par les Savoie en 1701.
C’est donc la dynastie des Savoie qui va finalement l’emporter au Piémont, surtout à partir du Comte Vert, Amédée VI, qui obtient en 1379 la reddition de Biella au nord, et en 1382 celle de Cuneo au sud. Son fils Amédée VII, le Comte Rouge, ajoute à ses domaines Mondovì en 1396, Vercelli en 1427, Chivasso en 1435, et l’empereur concède en 1416 le titre de duc à Amédée VIII, qui deviendra pape de 1440 à 1449 sous le nom de Félix V. Les comtes puis ducs de Savoie furent longtemps pris entre la France et le duché de Milan sur le plan international, mais dès cette époque, ils apparurent comme la principale et quasi exclusive puissance piémontaise, à qui ne manquaient que quelques vallées alpines (Valle Varaita, Val Chisone et haute vallée de Suse sujettes au Parlement de Grenoble avec les communautés du Briançonnais et du Queyras).
Le renforcement des grands principats territoriaux va de pair avec la soumission des petits nobles ruraux jusqu’alors indépendants, et des grandes familles nobles de la ville qui avaient commencé à investir dans des propriétés foncières à la campagne, dans leurs châteaux ou villas ; parmi ceux-ci, les banquiers se transforment au XIVe siècle en seigneurs ruraux vassaux des princes, sans pour autant abandonner leur activité de banquiers qui leur permet de fournir en argent les Savoie et les Visconti, en échange d’offices et d’investitures très rentables. Le lien entre la politique et la finance se resserre ainsi étroitement : les banquiers deviennent des seigneurs féodaux, et les politiques se créent une cour de banquiers capables de les aider financièrement. Par ailleurs les Visconti ont pour politique d’affaiblir les communes en leur ôtant une partie de leur environnement rural dont ils font de nouvelles petites seigneuries qui leur sont soumises, ayant été libérées de la tutelle de la commune. Ainsi se crée une nouvelle noblesse unie autour du prince ; un des meilleurs exemples est la famille de financiers de Vitaliano Borromeo à qui est donné un vaste territoire autour du Lac Majeur, et qui passe presque au niveau d’une noblesse princière. Il ne faut pourtant pas en conclure qu’il s’agit d’un retour à la féodalisation passée, car ces nouvelles féodalités sont peu stables, pouvant être revendues ou échangées à volonté ; elles ne correspondent qu’à un renforcement d’une nouvelle forme de pouvoir d’État.
Cette évolution transforme le rôle et l’importance des villes piémontaises, parmi lesquelles Turin devient centrale ; sa position géographique est déterminante pour le recentrage de l’administration des Savoie, dont le cœur est encore de l’autre côté des Alpes, mais où les possibilités d’expansion vers l’ouest sont annulées par le rattachement du Dauphiné à la couronne de France en 1349. L’évêque est à Turin, et c’est là que se transfère en 1403-04 l’Université qui avait envisagé de s’installer à Vercelli. Or c’est dans la principale faculté de l’Université, celle de Droit et Jurisprudence que se forment les juges et conseillers qui seront à la base de l’administration politique. Turin devient donc le centre intellectuel et bureaucratique des Savoie ; comme par ailleurs les domaines turinois deviennent plus importants et plus riches que ceux de la Savoie, on peut dire que la décision de transférer la capitale de l’État de Chambéry à Turin est prise dès le début du XVIe siècle, bien avant la décision formelle d’Emmanuel Philibert en 1573. En 1459, Ludovic de Savoie fait transférer de Moncalieri à Turin le « Consiglio cismontano » (qui s’occupe des impôts du duc, du rappel des troupes et des tribunaux). Turin est élevée au rang d’archevêché en 1515. C’est encore le duc d’Orléans qui contrôle la ville d’Asti ; un des ducs deviendra roi de France en 1499 sous le nom de Louis XII et se servira de cette possession pour revendiquer des droits sur l’Italie.
Cette centralisation sur un petit nombre d’États se traduit par l’apparition de nouveaux organismes de gouvernement et de nouvelles bureaucraties. Chaque État est un agrégat de villes, de seigneurs et de communautés rurales qui se sont soumis individuellement à des conditions précises, le prince doit nommer des fonctionnaires locaux pour les représenter, maintenir l’ordre, faire respecter les contrats, juger les procès et ramasser les impôts ; ce personnel est rémunéré par le prince et doit présenter des comptes rendus écrits de ses activités, mais les postes sont accordés à ceux qui les achètent ou les louent, quitte à ce qu’ils soient sous-loués moyennant finances et à devenir héréditaires. Cela coûte cher à l’État et diminue son efficacité, la complexité de plus en plus grande de la gestion obligeant à multiplier les charges, dans lesquelles s’infiltre la noblesse « de robe », les notaires et juristes enrichis au service du prince, faisant de chaque conseil un lieu de pouvoir dominé par des clans d’amis et de relations qui constituent une élite capable de gérer la politique au niveau régional. Les princes recherchent dans chaque État les personnes les plus susceptibles de les servir et de leur être fidèles, juristes, trésoriers. À partir de la seconde moitié du XVe siècle, on peut estimer l’importance du budget d’un État : 7 à 800.000 ducats d’or par an pour le duché de Milan, 150 à 200.000 pour le duché de Savoie. Les luttes sont terribles et souvent mortelles entre les clans qui cherchent à conquérir les postes et à exercer le pouvoir par tous les moyens, de la corruption à la violence, dans une ville. Alessandro Barbero donne l’exemple de Cuneo : « À Cuneo, dans la seconde moitié du XVe siècle, le général des Finances du duc de Savoie, Ruffino de’ Morri, domine la vie politique de la commune, fait entrer qui il veut dans le conseil communal, manœuvre l’élection du vicaire et les adjudications les plus juteuses, les assurant à des amis et parents ; si nécessaire, il intimide le conseil communal par des menaces, il en exclut les rares qui osent s’opposer à lui et les remplace par des hommes de paille, « plébéiens, ignorants et venus de la campagne », comme commente un contemporain scandalisé, ou bien il les fait se réunir illégalement en temps de peste et sans nombre légal, et il peut le faire parce qu’il sait pouvoir compter à la cour sur des couvertures si solides qu’aucune protestation provenant de Cuneo ne pourra jamais être écoutée » (Op. cit., p. 191).
Autour du prince se constitue aussi une cour, qui ne doit pas être confondue avec les organismes de gouvernement : ce sont les services qui s’occupent de la vie du prince, de sa nourriture, de son trousseau, de son mobilier, de sa garde-robe, de sa chasse, de ses chevaux et de ses chiens. Les membres de cette cour sont des gentilshommes influents du fait de leur proximité physique avec le prince, majordomes, chambellans, écuyers. En 1504 Charles II de Savoie dispose de 16 majordomes, et pour donner du travail à tous ses courtisans, il les fait nommer par trimestres.
La chasse, au faucon ou aux lévriers restera un des loisirs préférés de l’aristocratie de Savoie ; les tournois avaient été très pratiqués, en particulier par le Comte Vert à la fin du XIVe siècle ; ils avaient disparu avec la vieille féodalité (en France, Catherine de Médicis les interdit en 1559 à partir de la mort de Henri II dans un tournoi). Mais la chasse était une pratique permanente dans la famille de Savoie, peu portée sur les études et la littérature ; jusqu’à Victor Emmanuel II, on pratiqua à la cour des battues de chasse. Les territoires de la plaine du Pô étaient alors disséminés de forêts où abondaient les sangliers, les cerfs, les lièvres, les lapins sauvages, les volatiles ; c’était d’abord non seulement une pratique sportive, mais la source d’un complément alimentaire nécessaire à une époque où le bétail mal alimenté n’est pas assez nourrissant. Les plébéiens des communes avaient aussi l’autorisation de chasser, mais ils devaient recevoir et loger les princes lors des grandes battues. Plus tard, les Savoie se firent construire de grandes résidences de chasse tout autour de Turin, Venaria, Stupinigi, Racconigi. Mais une des caractéristiques du Piémont est de réunir des assemblées, parlements généraux de vassaux et de représentant des communes rurales. La première dont on ait la trace se déroule le 9 mars 1305 à Trino, dans le marquisat de Montferrat, avec 67 vassaux et 59 députés des communes rurales, événement politique nouveau et moderne, qui manifestait que cette société voulait faire entendre sa propre voix dans les prises de décision politiques. Ce ne fut jamais le cas ni du duché de Milan ni de villes comme Florence ou Venise. Ces assemblées, appelées des « Trois États » étaient réunies surtout pour décider des « subsides » à accorder au prince et des taxes payées par chaque commune, mais parfois elles prenaient aussi des décisions politiques dans les moments de crise ou d’urgence. Ce fut un mode de prise de décision politique original et propre au Piémont. Cela limitait les luttes locales entre les clans et la pratique de l’intimidation et de la violence, à la différence de ce qui était pratiqué dans le voisin duché de Milan, plus centralisé et moins « démocratique ». Les communautés rurales avaient d’ailleurs la possibilité de recourir directement au prince lorsqu’elles avaient un conflit avec le seigneur local ; le prince fait alors intervenir un de ses officiers pour régler le problème. Il n’y eut dans le Piémont qu’une grande révolte paysanne en 1383 à la mort du Comte Vert, que le successeur, le jeune Amédée VII, appelé par les paysans contre les nobles locaux, mit plus de cinq ans à régler. Ce fut une exception : toujours les problèmes furent réglés par voie judiciaire, selon les règles édictées dans les Statuta Sabaudiae Ducalia d’Amédée VIII.
Dans le domaine religieux, les ordres traditionnels stagnent, les donations faites aux Bénédictins diminuent, ils apparaissent dorénavant comme inutiles, immobilisant d’immenses richesses territoriales, le prestige de leurs moines et le nombre de vocations sont en baisse : le pape met en « commende » beaucoup d’abbayes, c’est-à-dire les confie à un administrateur laïque, c’est le cas de Staffarda (1462), de la Novalesa (1479), de San Michele della Chiusa (1381), de Villar San Costanzo, de Santa Maria de Pinerolo. Par contre naissent de nouvelles institutions, les ordres « mendiants », Franciscains et Dominicains, masculins et féminins (les Clarisses) portés par une grande piété populaire ; au début, ils ne s’installent pas dans des couvents, mais se présentent sous forme de prêcheurs, très écoutés et reconnus. Puis bientôt, abandonnant l’idéal de pauvreté christique de François d’Assise, ils s’installent dans de grands couvents qui deviennent aussi des centres de lutte contre les « hérésies » et des lieux de sépulture des princes.
Par ailleurs des mouvements de « pauvres » forment des communautés nouvelles comme les « Umiliati » qui vivent une expérience spirituelle tout en continuant leur travail de filature de la laine ou de tissage. Ces mouvements se divisent bientôt entre ceux qui veulent s’installer dans l’institution et ceux qui veulent continuer à pratiquer une pauvreté totale ; les premiers acceptent des charges de trésoriers ou des postes d’évêques, les seconds apparaîtront comme socialement dangereux et seront excommuniés, condamnés et parfois brûlés par l’Inquisition. Car l’Église officielle se mondanise, « toujours plus dominée par la politique, par le clientélisme et par le profit » (Alessandro Barbero, op. cit. p. 201).
Parmi les mouvements de pauvres présents au Piémont, il faut compter quelques Franciscains, comme Angelo Carletti de Chivasso (1411-1495, Vicaire général de l’Observance, fondateur de monts-de-piété) et Antonio de Vercelli, ou des prophétesses comme Caterina de Racconigi (1486-1547), du Tiers Ordre dominicain, fille d’un serrurier et d’une tisserande. Mais le plus important de ces mouvements et le seul qui existe encore fut celui des « Valdesi », disciples de Pierre Valdo de Lyon (1140-1206 ?) et qui trouvent refuge dans les hautes vallées du Piémont. Beaucoup d’autres mouvements de ce type eurent une forte influence, les « Apostolici », fondés à Parme par Gherardino Segarelli, brûlé en 1300 et remplacé par Fra Dolcino (1250-1307), originaire de Novare, jusqu’à ce qu’ils soient anéantis en 1307 et leur chef brûlé par l’Inquisition. Au cours des XIVe et XVe siècles, celle-ci se fait au Piémont de plus en plus cruelle dans la répression des « hérétiques » et des Juifs, très présents dans les villes piémontaises (banquiers, médecins, éditeurs, libraires …) et très tôt enfermés dans leurs « ghettos » (Turin 1457). À ces répressions s’ajoutent les procès contre les « sorcières », dans une forme de paranoïa collective qui considère ces représentantes de l’ancienne culture populaire comme de dangereuses alliées du diable représentant un danger mortel pour la société civile et religieuse et devant par conséquent être férocement combattues.
Les laïques participent à la vie spirituelle à travers toute une série de manifestations autour des paroisses, des monastères et des associations pénitentiaires qui célèbrent de plus en plus le culte de la Vierge Marie : Santa Maria d’Oropa (culte de la Vierge Noire), sanctuaire de la Madonna della Consolata à Turin. C’est aussi l’époque où commencent à se créer dans le Piémont et en Lombardie les « Sacri Monti » de Varallo, d’Oropa, de Varese, etc. qui vont offrir des lieux de pèlerinage dédiés à la Passion du Christ ou à la vie de la Vierge ou de François d’Assise à tous ceux qui n’osent plus se rendre en Terre Sainte. A. Barbero conclut : « Au Piémont aussi, nous touchons de la main la contradiction qui est celle de toute la société européenne à cette époque, c’est-à-dire d’une société extraordinairement vitale et créative, dans une vigoureuse croissance économique et culturelle, et en même temps proie de sombres obsessions et sujette à un très dur assujettissement de la part du pouvoir laïque et ecclésiastique » (op. cit. p.208-09).

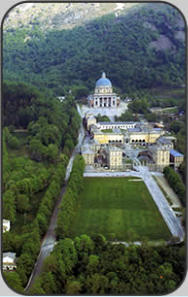

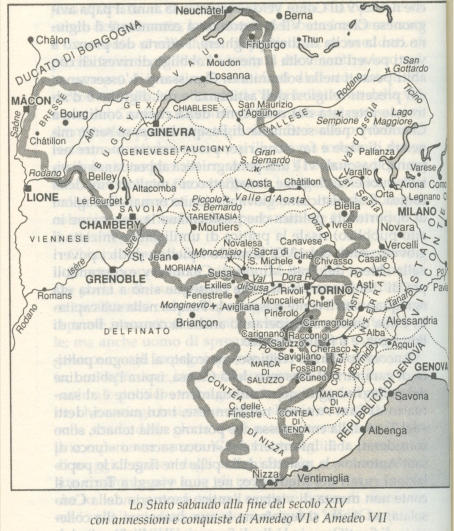
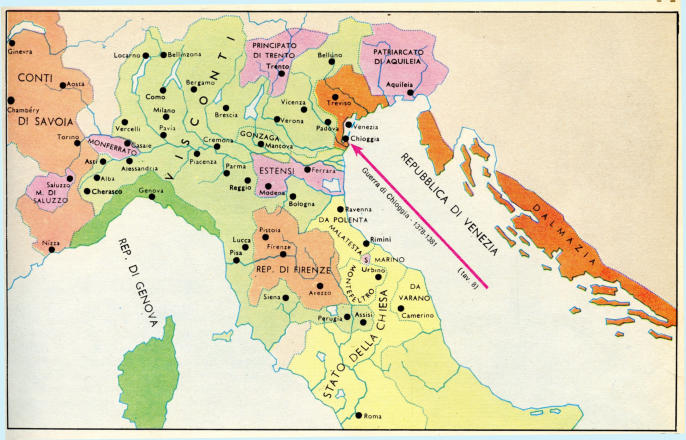



De 1494 à 1748, le jeu des Savoie entre la France et l’Espagne. Lieu de passage européen essentiel, le Piémont avait toujours été convoité par les grandes puissances voisines. Déjà à la mort du Comte Rouge Amédée VII en 1391 à l’âge de 28 ans, les clans français se déchaînent pour le contrôle de sa succession, soutenus par sa mère la comtesse Bonne de Bourbon favorable au duc de Bourbon, ou par sa femme Bonne de Berry favorable au duc de Berry, tandis que le duc de Bourgogne vise la succession par le biais de sa fille Marie, fiancée encore dans l’enfance à Amédée, le fils du Comte Rouge qui n’a encore que trois ans !
Plus tard, c’est le conflit entre la France et l’empire espagnol, en lutte pour l’hégémonie en Europe et dans la Méditerranée, qui conditionnera l’évolution du Piémont. La France a besoin de la fidélité des ducs de Savoie et des marquis de Saluzzo pour assurer le passage de ses armées vers l’Italie à travers les Alpes. L’Espagne craint la présence française dans le Piémont, qui menace ses possessions de la plaine du Pô (le duché de Milan) et la route de la Méditerranée aux Flandres et à l’Allemagne à travers les cols des Apennins ; c’est pourquoi elle gardera le contrôle du marquisat de Montferrat (la place forte de Casale Monferrato) jusqu’à la guerre de succession espagnole. Les ducs de Savoie ne pourront donc jamais mener une politique indépendante pendant cette période et devront penser le développement de leur État en jouant de l’alliance tantôt avec l’un tantôt avec l’autre, dans une région constamment traversée par des armées étrangères qui font peser un poids insupportable, économique, militaire et politique. Le marquisat de Saluzzo ne sera assimilé par les Savoie qu’en 1588 et celui de Montferrat qu’en 1713.
Le Piémont souffrit d’abord des guerres d’Italie jusqu’en 1559, oscillant entre la France et l’Empire (on réveille les termes de « guelfes », partisans de la France, et de « gibelins » partisans de Charles-Quint), selon que la victoire est française (François 1er vainqueur à Marignan en 1515) ou espagnole (capture de François 1er à Pavie en 1525). Le Piémont est souvent rattaché à la France (comme de 1536 à 1559), perdant parfois presque toute existence, et toujours parcouru par les armées française, espagnole ou suisse (les redoutables mercenaires suisses) qui pillent, ravagent, violent des populations terrorisées.
Mais la faiblesse du Piémont tient d’abord à celle de l’État savoyard, à l’arriération de sa cour et à la médiocrité de ses dirigeants. Le Comte Vert, Amédée VI avait été un dirigeant énergique, à la tête d’une cour brillante ; il élimine son rival, le prince Filippo d’Acaia, organise une croisade réussie en 1365-66 contre les Turcs. Son fils, le Comte Rouge, meurt jeune à 26 ans, remplacé par le long règne d’Amédée VIII, diplomate subtil à qui l’empereur Sigismond de Luxembourg accorde le titre de duc, qui agrandit les terres des Savoie et réorganise l’État de Savoie (Statuts de 1430). En 1434, il abandonne l’administration du duché à son fils Ludovic et se retire au monastère de Ripaglia, sur le lac de Genève, avec les principaux personnages de sa cour, où il mène, dira le futur pape Pie II, une vie peu monacale, mais d’où il s’arrange pour être élu pape en 1439 sous le nom de Félix V, contre le pape en place Eugène IV. Mais son entreprise, dont il pensait surtout qu’elle allait favoriser l’État de Savoie, trouve peu d’échos, et il renonce en 1449 en abdiquant auprès du nouveau pape Nicolas V. Il meurt le 7 janvier 1451 à Genève, « achevant une existence de finesses politiques, de soins administratifs et de ruses diplomatiques » (Gianni Oliva, op. cit. p. 146). Ses successeurs seront dans l’ensemble médiocres, son fils Ludovic, puis Filiberto I, Carlo I, Filippo II « Sans terre », puis Carlo II dit « Le Bon », duc de 1504 à 1553, de caractère indécis et de peu d’autorité, à qui il ne restera qu’une bande de terre étroite, de la vallée d’Aoste à Nice.
Dans ces conditions, la cour de Savoie resta une cour plus proche de celles du Moyen-âge que des nouvelles cours brillantes de la Renaissance : les Savoie étaient trop pauvres pour constituer des résidences, des châteaux, des fêtes exubérantes comme les cours de Florence, de Rome ou de Venise. Après le règne des « trois Amédée », l’évolution des Savoie avait ralenti, il faudra attendre l’arrivée d’Emmanuel-Philibert pour que la progression reprenne et rejoigne la grandeur des nations modernes qui maintenant dominaient l’Europe, la France, l’Espagne, l’Autriche impériale.
La défaite que le duc de Savoie Emmanuel-Philibert, gouverneur des Pays-Bas et général des armées impériales, infligea aux Français à Saint-Quentin en 1557 conduisit à la paix de Cateau-Cambrésis en 1559, qui restitua aux Savoie les régions que la France avait conquises. Mais la France gardait le contrôle de 5 forteresses (Turin, Chieri, Chivasso, Villanova d’Asti et Pinerolo), l’Espagne de 2 (Asti, Santhià, plus Novara et Alessandria). Emmanuel-Philibert profita ensuite de la guerre civile en France (massacre de la Saint-Barthélemy le 24 août 1572) pour récupérer ses forteresses ; son successeur Charles Emmanuel I profita aussi de la crise française pour annexer en 1588 le marquisat de Saluzzo, mais dut céder à la France en échange la Bresse et le Bugey (Traité de Lyon de 1601), augmentant son éloignement de la partie française du duché.
Le XVIIe siècle fut marqué par une alternance d’alliance des Savoie avec la France et avec l’Espagne, entrecoupées d’épisodes de peste dont celle de 1630 décrite par Manzoni dans Les Fiancés. Les Français de Richelieu l’emportèrent et le Traité de Cherasco de 1631 fit remettre aux Savoie une partie des territoires du marquisat de Montferrat, en échange de la Val Chisone et de la forteresse de Pinerolo, la plus inaccessible du Royaume et destinée aux prisonniers d’État comme Nicolas Fouquet, gardé par d’Artagnan et ses mousquetaires et, plus tard, comme le Masque de Fer. Jusqu’en 1659, armées française et espagnole se livrèrent aux assauts, conquêtes, pertes, nouveaux assauts, provoquant la misère et souvent la mort de toute la population. Cela fut aussi cause de guerres civiles internes à la Maison de Savoie : en 1637 meurt le duc Victor Amédée I, la régence est assurée par Marie Christine de France, sœur de Louis XIII et favorable à la France ; l’Espagne suscita contre une rébellion de ses beaux-frères, Tommaso et Maurizio qui s’emparèrent du Piémont jusqu’à ce que les troupes françaises reconquièrent les villes perdues. Mais après la mort de Christine, le Piémont fut pratiquement un vassal du Roi Soleil, et consacré à des guerres comme la guerre du Sel, contre la contrebande et l’hostilité populaire à la gabelle, et la guerre contre les Vaudois imposée par Louis XIV après la révocation de l’Édit de Nantes en 1685.
De 1690 à 1715, le Piémont s’allia à l’empire contre Louis XIV à qui il avait refusé la forteresse de Turin. En mai 1706, la France assiégea Turin, encerclant la citadelle très efficace construite pour Emmanuel Philibert par l’architecte Francesco Paciotto, selon les nouveaux critères de fortification développés par Francesco di Giorgio Martini à la fin du XVe siècle ; sous la forteresse, un jeu de « mines » et de « contre-mines » permettait d’arrêter les assiégeants qui tenteraient de détruire les murailles ; c’est ce que fit Pietro Micca dans la nuit du 29 au 30 août 1706, en faisant exploser un groupe de soldats français qui s’étaient infiltrés dans un conduit souterrain. Cela prépara la victoire du prince Eugène de Savoie qui écrasa les troupes françaises le 7 septembre, épisode glorieux de l’armée piémontaise toujours fêté aujourd’hui et qui fut à l’origine de la construction de la basilique de la Superga. Malgré une dure période de froid (l’année 1709 est la plus froide de l’histoire) et de famines répétées (1693-4 et 1709-10), ce fut le début d’une reprise et d’une période de prospérité : en 1713, au Traité d’Utrecht, Victor Amédée II arrache la couronne de roi de Sardaigne ; en 1738, Charles Emmanuel III (1730-1773) obtient Novare et Tortona, et en 1748 à la paix d’Aquisgrana, il annexe Vigevano, Voghera et le Haut Novarese, portant la frontière du Piémont sur le Ticino.


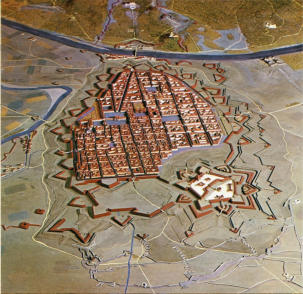

Ducs de Savoie (1416-1675)
- 1416-1451 : Amédée VIII le Pacifique (1383-1451)
- 1451-1465 : Louis Ier (1402-1465), fils du précédent
- 1465-1472 : Amédée IX le Bienheureux (1435-1472), fils du précédent
- 1472-1482 : Philibert Ier le Chasseur (1465-1482), fils du précédent
- 1482-1490 : Charles Ier le Guerrier (1468-1490), frère du précédent
- 1490-1496 : Charles II « Le Bon » (1489-1496), fils du précédent
- 1496-1497 : Philippe II sans Terre (1438-1497), grand-oncle du précédent, fils de Louis Ier
- 1497-1504 : Philibert II le Beau (1480-1504), fils du précédent
- 1504-1553 : Charles III (1486-1553), frère du précédent
- 1553-1580 : Emmanuel-Philibert Tête de Fer (1528-1580), fils du précédent
- 1580-1630 : Charles-Emmanuel Ier le Grand (1562-1630), fils du précédent, origine des Savoie-Carignano.
- 1630-1637 : Victor-Amédée Ier (1587-1637), fils du précédent
- 1637-1638 : François-Hyacinthe (1627-1638), fils du précédent
- 1638-1675 : Charles-Emmanuel II (1634-1675), frère du précédent
8) Vers le régime absolutiste des Savoie
La construction de la forteresse de Turin était une illustration de la révolution militaire qui transforme alors le Piémont. L’évolution des techniques de guerre, l’apparition de l’artillerie, rendent inutiles les anciennes fortifications, et exigent la construction de nouvelles forteresses à bastions ; le siège de ces villes fortifiées remplaça la bataille classique. Dès son arrivée au pouvoir, Emmanuel-Philibert s’employa à la construction de villes fortifiées, à Turin d’abord, puis Vercelli, Ceva, Savigliano, Cuneo, Mondovì, malgré la pauvreté de ses moyens financiers. Ces chantiers coûtaient cher mais apportaient aussi du travail à une main-d’œuvre importante (plus de 2000 maçons travaillèrent à la citadelle de Turin).
Cette transformation comporte aussi l’institution d’armées permanentes qui remplacent progressivement les compagnies mercenaires et celles qui étaient fournies par les nobles composées de cavaliers dont l’entretien était à leur charge. La révolution militaire avait rendu prédominante l’infanterie, bien armée de piques et d’arquebuses, qui l’emportait sur la cavalerie cuirassée. Sous Charles Emmanuel II sont créés les premiers régiments permanents d’infanterie dont chacun aura un nom permanent et non plus celui de son colonel ; sous Victor Amédée II, les forces passent de 7500 hommes en 1682 à 25 000 en 1704. Pour entretenir et payer ces soldats permanents, on lève un impôt spécifique appelé « Quartier d’hiver ».
Le régime plus centralisé et absolutiste des Savoie impose à ses sujets de nouvelles charges fiscales. Emmanuel-Philibert avait considérablement augmenté l’impôt sur le sel, qui s’ajoutait à toutes les autres taxes, gabelles, fouages déjà ramassés auprès des communautés qui parvenaient difficilement à faire face à ces dépenses fiscales : pour avoir de l’argent rapidement, les ducs vendaient même à des banquiers le droit de recueillir les taxes, et que les villes et les communautés devaient ensuite payer. Pour financer les guerres, on levait des impôts extraordinaires, par exemple sur le blé auprès des paysans (1601). Mais on levait aussi des impôts pour payer les mariages, les voyages princiers, mais surtout les entreprises militaires. Tout cela diminue l’autonomie des communautés locales, en diminuant leurs revenus et en les rendant plus dépendantes du pouvoir central à qui elles demandaient des exemptions, en échange de liens de gratitude. On institua de plus peu à peu une péréquation entre les communes, qui permit au duc de s’ingérer dans la gestion des finances locales. L’État contrôlait aussi le commerce, les péages, les douanes, les axes routiers. Tout cela coûtait cher à ses sujets, mais permit aux Savoie de limiter considérablement la dette publique qui n’était que du triple des rentrées annuelles, alors qu’elle était de 7,5 pour un en Toscane, 13 pour un à Venise, et 17 pour un dans l’État de l’Église.
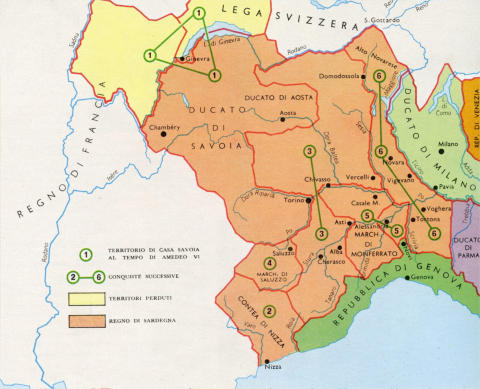
Cette évolution de l’État dans un sens absolutiste se traduisit aussi par une réorganisation des institutions de gouvernement, des changements de nom et de fonctions : le duc prenait ses décisions seul après n’avoir consulté que ses secrétaires favoris ; les deux « Consigli cismontani » de Turin et Chambéry devinrent des « Sénats » ; le dédoublement de la Chambre des Comptes fut aussi maintenu ; l’augmentation de la fiscalité imposa une multiplication des offices de Trésorerie. Les « Secrétaires d’État » passèrent de 8 en 1580 à 23 en 1619 et à 42 en 1628 ; le premier secrétaire était une sorte de premier ministre.
Cela se traduisit par la constitution d’une élite, qui devint plus turinoise que savoyarde, et qui constitua le plus sûr moyen d’ascension sociale : les « bourgeois » d’origine, juristes et financiers, constituèrent une nouvelle aristocratie propriétaire de grands palais et titulaires de fiefs, composée des anciens notaires, avocats, financiers, marchands qui avaient fait carrière au service de l’État. Il fallait 3000 ducats de rente annuelle pour être nommé comte, 4000 pour être nommé marquis !

Le prince devient une « Altesse » qui a un rapport de domination sur sa cour, dans un rapport entre maître et serviteurs, car il tient son pouvoir de la grâce divine : Emmanuel-Philibert avait été élevé à la cour de Philippe II d’Espagne et en avait importé les formes. La cour du duc devint « une scène indispensable pour maintenir la foi dans l’idéologie princière » (Barbero, op. cit. p. 245) ; Emmanuel-Philibert eut une cour de 200 personnes plus les 90 de la cour de la duchesse Marguerite de Valois ; Marie-Christine de France avait à elle seule 300 personnes à son service, et cela représentait 31% des dépenses de l’État. Ainsi se forma une noblesse toujours moins soucieuse de son autonomie et toujours plus dépendante de la cour princière, où les fêtes, les bals, les spectacles contribuaient à affirmer la centralité de l’État dans la société piémontaise.
Un autre moyen d’ascension sociale et une source de revenus était la carrière militaire, tant pour les bourgeois qui achètent une charge et deviennent capitaines que pour les paysans qui deviennent soldats, sont payés et ont une retraite.

Turin se confirme bientôt comme la nouvelle capitale ; elle est la seule ville du Piémont à augmenter régulièrement sa population : 14 244 habitants en 1571, 24 000 en 1614, 44 000 en 1700, alors qu’aucune autre ne dépassera 8500 habitants. Elle jouit de privilèges et d’exemptions fiscales, elle n’a pas l’obligation de payer l’hébergement des troupes, et cela attirait de nouveaux habitants, ce qui n’évite pas les conflits entre le duc et la commune, en particulier avec les marchands et artisans, plus imposés. Le développement de Turin fut suivi par de grands architectes, Ascanio Vitozzi, Carlo et Amedeo Castellamonte et géré par le nouvel organisme du « Magistero delle fabbriche » ; les palais nobiliaires et les grands églises baroques se multiplièrent ; les nouvelles fortifications furent assez puissantes pour résister aux attaques des Français en 1706. Et tout autour de la ville se construisit la « couronne de délices » des villas ducales, de Villa della Regina à la Venaria Reale.

Le duc et sa cour s’approprient toujours plus la vie religieuse et festive qui est marquée d’un sceau dynastique plus que municipal : les reliques des anciens martyrs, Avventore, Solutore et Ottavio, toujours honorés comme protecteurs de la ville sont confiées aux jésuites dans la nouvelle église des Saints Martyrs et la procession en leur honneur est dominée par le duc et sa cour, sans que les citoyens y jouent le moindre rôle : lors de la procession si importante du Corpus Domini, ce sont les nobles de cour qui portent le baldaquin ; à la Consolata, Charles Emmanuel éloigne les moines et les remplace par un ordre qu’il favorise, les « Foglianti »; l’église San Lorenzo est édifiée sur piazza Castello parce que c’est le 10 août, jour de la fête du saint, qu’Emmanuel-Philibert avait gagné la bataille de Saint-Quentin ; le culte du Saint Suaire, propriété du duc, transféré de Chambéry à Turin en 1578, fait l’objet de grandes fêtes présidées par le cardinal Carlo Borromeo, moment de communion entre le peuple et la dynastie, et le cardinal dut insister pour que la relique fût déposée dans une chapelle du Dôme plutôt que dans un oratoire privé du palais ducal.
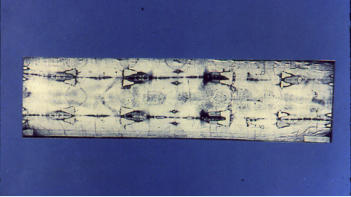
L’absolutisme ducal s’appuie en effet beaucoup sur une Église dont la hiérarchie est plus politique que religieuse ; les évêchés étaient attribués aux enfants et parents des familles nobles, sources de revenus et de pouvoirs sans aucune obligation de résidence et où l’évêque avait la possibilité de se faire représenter par un vicaire qu’il nommait lui-même. C’est à Turin que culmina ce système de nominations politiques, de népotisme, de cumul des charges, d’absentéisme. Ainsi les Della Rovere occupèrent longtemps l’archevêché de Turin : Domenico Della Rovere cardinal à 35 ans, devint évêque de Turin en 1482, c’est lui qui fit édifier la nouvelle façade du Dôme ; habitant Rome, il se faisait représenter à Turin par son neveu Giovan Lodovico qu’il nomma pour le remplacer en 1501 ; et ce Giovan Domenico nomma son neveu Giovan Francesco qui prit le siège en 1515 ; leur succédèrent les Cibo, dont les vicaires furent d’autres Della Rovere ; dont l’un occupa à nouveau le siège jusqu’en 1582. Mais le même système régnait dans les autres évêchés, à Vercelli (les trois fils du puissant financier Sebastiano Ferrero), à Saluzzo (Giovanni Andrea, cousin du pape Jules II Della Rovere, céda l’évêché à son frère Sisto, et Saluzzo ne vit jamais ni l’un ni l’autre). Le Concile de Trente ne réussit pas à modifier le système, car le duc de Savoie avait le droit d’approuver les candidats, c’est-à-dire en fin de compte de les nommer ; un des fils de Carlo Emanuele I, le prince Maurizio, fut nommé cardinal à 15 ans et évêque de Vercelli à 19 ans. Le même système fonctionnait pour les nominations de commanditaires des monastère bénédictins : en 1687, Victor Amédée II voulut s’attacher son jeune cousin, le prince Eugenio di Savoia, il lui attribua les commendes de deux de ses monastères.
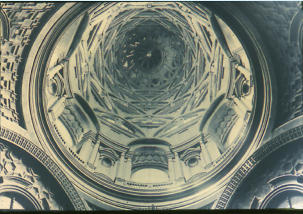
Par contre, la Contre Réforme parvint à discipliner un peu le clergé séculier, appauvri, peu cultivé (sachant mal le latin), concubinaire. Et la période vit apparaître de nouveaux ordres religieux, organisés, disciplinés et efficaces, en particulier dans la lutte contre les protestants, en premier lieu les Jésuites, favorisés par Emmanuel-Philibert « pour tenir ses sujets dans la sainte crainte de Dieu et la confirmation de la sainte foi catholique ». Ils ont une position sociale élevée, une culture chevaleresque et un esprit militaire qui en font l’instrument idéal pour prêcher contre les protestants, et les Vaudois. Avec eux interviennent les Capucins, et des ordres enseignants comme les Barnabites, les Oratoriens, les Théatins (auxquels appartenait l’architecte turinois Guarino Guarini), les Carmélites et les Feuillants (« i Foglianti ») venus en 1592 d’une séparation des Cisterciens français et qui furent installés à la Novalesa, à Staffarda, à Pinerolo et au sanctuaire de la Consolata de Turin. Les religieux constituaient donc un pourcentage important de la population : à Turin en 1703, 4,3% du total, soit 818 prêtres, 760 moines, 397 religieuses. L’Inquisition se livre à la chasse aux sorcières, surtout dans les zones de montagne entre 1570 et 1620, et à la répression du protestantisme qui s’est répandu parmi les intellectuels (Université de Turin) comme parmi les marchands et ouvriers textiles de Chieri. En 1565, un édit d’Emmanuel-Philibert ordonne à tous les protestants d’abjurer ou de quitter le pays. Les communautés protestantes disparaissent aussitôt pour se réfugier à Genève ou à Lyon ; le calvinisme subsiste au contraire à Saluzzo, ce sera en 1588 le prétexte offert à Charles Emmanuel I de conquérir le marquisat de Saluzzo pour en éliminer cette « secte abominable ». Pour les persécutions contre les Vaudois, voir dans l’annexe du dossier.

La diffusion de la doctrine catholique alla de pair avec la réforme de l’assistance aux pauvres des villes. Ce fut l’œuvre de la Compagnie de Saint Paul, confrérie créée en 1562 sous l’influence des Jésuites, qui ouvre le Mont de Piété de Turin en 1579, l’ « Hôtel de Vertu » en 1580 et l’Hôpital de la Charité en 1628 : il s’agissait de répondre au développement de l’usure qui endettait les couches les plus pauvres, d’instruire des enfants pauvres pour en faire des artisans de la soie, d’hospitaliser les malades mais aussi les pauvres pour éviter le scandale de la mendicité. La Confrérie de la Miséricorde assiste les condamnés à mort et a le droit d’en gracier un par an ; la Compagnie de Saint-Roch ensevelit les morts en temps de peste, et la compagnie de la Sainte Croix s’occupe de racheter les chrétiens devenus esclaves des Turcs. À cela s’ajoutent les confréries de dévotion, comme les Disciplinati, le Corpus Domini, le Rosaire ; le pouvoir central contrôle étroitement ces confréries, les utilisant pour l’endoctrinement de la population et la défense contre les hérésies. Les anciennes confréries, comme celle de l’Esprit Saint, qui se proposaient plus de promouvoir la solidarité communautaire par des distributions de vivres (les plats de lentilles) sont au contraire combattues par le duché qui se soucie d’abord de contrôler et canaliser la religiosité populaire. C’est dans le même but qu’il surveille les sanctuaires où se déroulent les grandes manifestations populaires de dévotion à la Vierge (sanctuaires d’Oropa, de Crea, ou celui plus récent de Vic, près de Mondovì) : en 1594 se répand le bruit que la fresque d’un pilier représentant la Vierge a saigné après avoir été frappée accidentellement ; aussitôt, Charles Emmanuel I fait gérer le lieu par des Jésuites et des Feuillants de sa connaissance et fait construire un grand monastère par Vitozzi pour en faire le centre d’un culte dynastique, y réaliser des pèlerinages avec la cour et y instituer sa propre sépulture, jusqu’à ce que le sanctuaire devienne lieu de pèlerinage de montagnards locaux hostiles à la gabelle sur le sel ! En 1706, Victor Amédée II fait construire la basilique de Superga pour célébrer sa victoire sur la France et en fait la sépulture dynastique, loin de toute religiosité populaire.

Pour augmenter son pouvoir, le duc féodalise ses terres, vendant de plus en plus de communautés sous forme de fiefs confiés à des vassaux soumis au duc, en même temps qu’ils lui fournissaient des ressources appréciables. Les acheteurs sont les financiers, les spéculateurs, les sous-traitants des gabelles, les notaires, les officiers ducaux qui matérialisent ainsi leur position sociale et structurent une nouvelle classe dominante (Voir la comédie de Tana d’Entracque, ‘l Cont Piolet, qui se moque de l’un de ces nouveaux petits nobles). Mais ces ventes sont aussi pour les grandes familles un moyen de se renforcer encore plus, comme les Benso qui n’achetèrent le fief de Cavour qu’en 1649. Le Piémont est alors considéré comme un pays riche, du fait de son agriculture qui produisait les 4 cinquièmes de sa richesse ; cela le rendait moins sensibles aux cycles de la conjoncture qu’aux guerres qui ravageaient la campagne et aux épidémies de peste, comme ce fut le cas au milieu du XVIIe siècle (guerres et épidémie de 1630) où la famine versa sur les routes des milliers de désespérés qui se réfugiaient dans les villes à pratiquer la mendicité ; la prospérité ne reviendra qu’après 1660, mais cela a contribué à renforcer l’importance de la capitale, seule ville capable d’absorber ces phénomènes : Turin a 44 000 habitants en 1700, alors qu’aucune autre ville du Piémont ne dépasse 8000 habitants.

L’agriculture produit surtout des céréales, blé, seigle, et peu à peu maïs réservé aux animaux et, dans les périodes de famine seulement, aux humains ; l’élevage bovin, facilité par l’irrigation des prés et l’abondance des canaux, gagne du terrain sur l’élevage ovin ; le développement de l’industrie de la soie pousse à l’implantation des mûriers. La population paysanne est constituée par une multitude de petits propriétaires (moins d’un hectare, ce qui obligeait à avoir aussi un travail salarié) possédant une minorité de la surface, face à une minorité de grands propriétaires aisés, souvent vivant à la ville, qui confiaient la gestion de leurs terres à des métayers qui habitaient sur place ans une maison en dur avec des toits de tuiles ou de lauses ; mais le métayage laisse parfois la place à une forme de gestion de type capitaliste, où les fermes sont louées à un entrepreneur qui les fait cultiver par des ouvriers agricoles. Le Piémont a donc vu disparaître la propriété féodale encore vivante ailleurs, et, grâce à la filature et au travail d’ouvrier agricole, les petits paysans ne sombrent jamais dans la misère. De plus, la production excédentaire permettait d’exporter céréales et viande, faisait place à une couche importante de commerçants, et poussait à un développement considérable des marchés et des foires. Enfin, le Piémont avait une population nombreuse de montagnards qui, pendant quelques mois de l’année, venaient travailler en ville comme ramoneurs, porteurs, palefreniers, porteurs d’eau, etc. tout en gardant leur maison dans le village où ils payaient leurs impôts, et où ils sont assurés de ne pas mourir de faim, grâce à la consommation des châtaignes.
Une autre couche sociale se développe dans cet État centralisé, c’est celle des financiers, qui prospèrent par le crédit qu’ils accordent aux princes et aux marchands, comme Agostino Quarino (qui dispose aussi d’une banque à Lyon) et toute une élite financière turinoise, les Gabaleone, Carello, Cane, Baronis, Negro, Giorgis, Gentile, Turinetto, Graneri, parfois soumis à d’énormes risques de faillite. Enfin, le Piémont commence à développer une première forme d’industrie, de la laine à Biella, de la toile pour les voiles des bateaux vénitiens et génois, du chanvre pour les cordages. Le plus grand centre industriel est Chieri, avec son industrie du coton ; la ville dispose d’une importante main-d’œuvre paysanne qui complète par son salaire une activité agricole insuffisamment rémunératrice. Le coton connaîtra ensuite la concurrence de la soie de Racconigi, dont le commerce avec la France (Lyon) est important. Ainsi, ce premier développement industriel se traduit par une intégration entre ville et campagne, avec des activités décentrées qui emploient beaucoup de paysans travaillant à domicile. Cela facilitera le développement technologique, particulièrement dans le domaine de la filature, qui fera du Piémont la région la plus avancée d’Europe dans ce domaine au XVIIIe siècle : à côté du travail à domicile commencent à se développer de grandes filatures industrielles, comme celle du comte Galleani à Turin, celle de Clerici et Lanzone à Mondovì, celle de Peirone à Racconigi (2500 ouvriers dans 19 établissements), qui emploie de 200 à 300 ouvriers.
9) Le XVIIIe siècle et l’occupation napoléonienne
Le XVIIIe siècle est pour le Piémont une période de croissance démographique et économique, avec des hauts et des bas, selon l’abondance des récoltes et les périodes de guerre : guerre de succession d’Autriche (1740-48) qui se déroule en partie au Piémont, entre les Français et les Autrichiens auxquels s’est allié Charles Emmanuel III, roi de Piémont Sardaigne : la guerre se termine par la paix d’Aquisgrana (Aix-la-Chapelle) par laquelle Marie Thérèse d’Autriche devient impératrice. Le traité d’Utrecht (1713) avait terminé la guerre de succession espagnole, et le Piémont y avait obtenu le Monferrato, la Lomellina, la Val Sesia et Alessandria ; en 1738, il s’était augmenté de Novara et Tortona ; avec le traité d’Aquisgrana, le Piémont obtient les vallées du Lac Majeur, Vigevano, Voghera, l’Oltrepò pavese et le haut Novarese. En 1700, le recensement fait apparaître 706 000 habitants ; on en compte 1. 377. 600 en 1734 ; après 1748, la population continue d’augmenter, le total est de 2. 168. 238 en 1774, la croissance a été de 26% en 40 ans. La population stagne après l’occupation de Bonaparte : de 1805 à 1814, les 5 départements entre lesquels est divisé le Piémont (Po, Dora, Stura, Marengo, Sesia) comptent 1 600 000 habitants, auxquels il faut ajouter les 240. 000 du département de l’Agogna (Novarese cédé au Royaume d’Italie), les 187. 000 de Tortona, Voghera et Bobbio (Département de Gênes) et les 140. 000 d’Acqui et Ceva (cédés au département de Montenotte), soit un total de 2. 167. 000 personnes.
L’agriculture reste le secteur dominant ; la population rurale représente environ 87%, la population urbaine 13%. On utilise encore les vaches et les bœufs pour le labourage, rarement les chevaux ou les mulets ; les rendements du blé sont au mieux de 4 à 5 fois la semence (11 à 12 fois en Angleterre) ; la culture du fourrage ou du trèfle alterne avec celle des céréales ; plus tard on alterne blé et maïs, ce qui permettait d’avoir toujours une alimentation garantie. Pour les céréales, la répartition était de 36% de blé, 27% de seigle , 20% de maïs, 12% d’avoine et d’orge, 5% de riz (qui atteint au contraire 13 à 19% dans les 4 provinces intéressées de Biella, Vercelli, Novara et Lomellina, et il passe de 7400 hectares en 1728 à 20 000 en 1792), en moyenne car le pourcentage est différent selon les régions. On exporte souvent le blé et on mange du pain noir de seigle ; le riz est totalement vendu ; le maïs est de plus en plus consommé provoquant une diffusion de la pellagre, due au manque de protéines animales.
Mais on cultive aussi la vigne (13% de la terre cultivée), du vin de qualité médiocre en plaine, de bonne qualité sur les collines (Barolo et Barbaresco). À Turin, on consomme en moyenne 250 litres par an et par habitant. Une autre force de l’agriculture piémontaise est l’élevage : 479. 000 bovins, 354. 000 brebis et chèvres, 91. 000 porcs, 19. 000 chevaux, 15. 000 mulets et 60. 000 ânes en 1734. Enfin les bois se ressentent de la transformation de la société : on déboise de plus en plus dans une économie en développement, bois à brûler, bois pour le charbon de bois, etc. Les filatures piémontaises consomment chaque année de 35. 000 à 45. 000 tonnes de bois de combustible. La majorité des paysans, en particulier les journaliers vivent encore mal, mais échappent à la misère, sauf dans les périodes de disette pour mauvaise récolte, où les journaliers se réfugient dans les villes pour devenir mendiants ; les salaires ne suivent pas la montée des prix ; vers le milieu du siècle, un homme gagne 10 sous par jour, une femme 5 à 6 ; dans les rizières, le salaire monte jusqu’à 30 sous par jour.

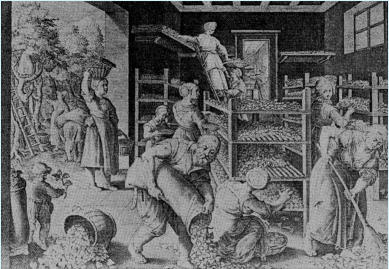
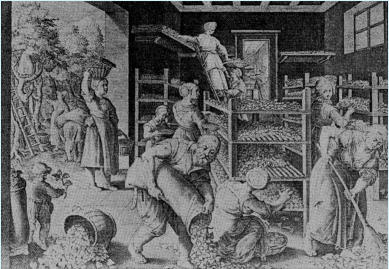
Portraits et lieux historiques
10) De la restauration de 1815 à l’Unité de l’Italie en 1861
Napoléon abdique le 6 avril 1814 ; le 14 mai, Victor Emmanuel I débarque à Gênes et il entre à Turin le 19 mai. Il est accueilli par une foule massée dans la via Po, du fleuve dont il franchit le nouveau pont construit par Napoléon jusqu’à Piazza Castello ; il est à cheval accompagné par les hommes à cheval de la Garde Urbaine, et gardé par 2000 soldats autrichiens. Le rôle des Savoie a été nul dans la coalition antinapoléonienne, mais le Congrès de Vienne a besoin de créer autour de la France quelques États coussins, et ce jeu des équilibres internationaux fait que le Piémont non seulement récupère ses États antérieurs mais s’agrandit vers la mer par l’annexion de territoires autrefois appartenant à la République de Gênes ainsi que le Haut Novarese jusqu’au col du Simplon. Par ailleurs Victor Emmanuel I n’a qu’une éducation de cour (les pas de danse et le cérémonial des manifestations !), aucune culture intellectuelle et aucune intuition de ce qu’il faudrait faire, malgré les sollicitations de sa femme Marie Thérèse d’Autriche, plus ambitieuse. Il chercha donc d’abord à séduire l’opinion publique en supprimant la conscription et quelques impôts, mais il maintint en place l’essentiel de l’ordre napoléonien : les Vaudois eurent le droit de conserver les propriétés acquises, les Juifs durent les vendre, mais la décision ne fut pas appliquée avec rigueur, et ils restèrent dispensés de porter un signe distinctif ; les diocèses furent reconstitués mais on les fit correspondre aux provinces ; les registres d’État civil furent rendus aux paroisses ; les congrégations furent rétablies, Jésuites compris, mais ne purent pas récupérer les biens confisqués ; tout ce qui renforçait l’autorité de l’État fut maintenu : livrets de travail, Gendarmerie appelée « Carabinieri Reali », système fiscal ; mais on abolit le système judiciaire napoléonien pour en revenir au système despotique donnant tout le pouvoir au roi.
Il n’y eut que peu d’épuration de l’ancien personnel administratif napoléonien, sinon au niveau des préfets, des présidents de tribunaux et des professeurs d’Université ; sur les 40% de notables qui avaient été en fonction sous Napoléon, seuls furent éliminés les plus enragés des jacobins, les plus hostiles aux feudataires locaux. Même au plus haut niveau, du gouvernement et de la diplomatie, on conserva des hommes qui avaient fait carrière sous Napoléon, même si le haut clergé et les extrémistes de la noblesse déclarèrent leur opposition aux « nouveaux riches issus de la bourgeoisie ».
Pour sa politique, Victor Emmanuel I a besoin d’une force militaire capable de maintenir le prestige de la dynastie vis à vis de la France et de l’Autriche, et l’ordre intérieur ; en un an il reconstitue une force qui peut mettre sur pied de guerre 96.000 hommes avec les réservistes, 8 régiments d’infanterie, 6 de cavalerie et la milice territoriale, auxquels s’ajoutent les Carabinieri reali qui combattront le brigandage, fruit aussi bien de la révolte politique que de la misère économique, en contrôlant les communications et les correspondances. Les carabiniers seront 2000 en 1816 et seront les garants de l’ordre intérieur restauré ; ils sont recrutés parmi ceux qui savent lire et écrire et sont d’une moralité et d’une fidélité politique sans failles. Ils seront la principale innovation de Victor Emmanuel I et resteront une des institutions italiennes les plus populaires. Dans l’armée s’était développé un patriotisme inspiré d’Alfieri et de Foscolo, mêlé à un libéralisme peu favorable à une monarchie tyrannique.

Victor Emmanuel I meurt en 1824 mais ne règne que jusqu’en 1821, il renonce au trône le 12 mars après les mouvements insurrectionnels de janvier 1821. Les idées libérales s’étaient en effet développées auprès des étudiants, des fonctionnaires et des professionnels hostiles à un régime d’absolutisme catholique qui interdisait toute forme d’association politique, et cela donna naissance à des cercles de sociétés secrètes, de francs-maçons et de « carbonari », comportant une part importante de l’élite noble et bourgeoise, parfois liée au prince de Carignano, futur roi Charles Albert. La plus importante fut la société dirigée par Filippo Buonarroti qui projette une insurrection destinée à contraindre le roi à accorder une constitution et à déclarer la guerre à l’Autriche pour libérer la Lombardie. Des mouvements civils et militaires se déclenchent entre janvier et mars 1821. Le prince de Carignano, nommé régent en attendant l’arrivée de Charles Félix, proclama la constitution, mais fut désavoué par Charles Félix devenu roi et dut s’exiler. Charles Félix noie l’insurrection dans le sang, prononçant 71 condamnations à mort (dont 69 par contumace), à la prison 255 insurgés, à la dégradation plus de 600 officiers et des centaines de sous-officiers et à de nombreux exils.
Le règne de Charles Félix dura dix ans, de 1821 à 1831. L’épuration des professeurs le conduisit à remettre l’enseignement entre les mains des religieux, surtout les Jésuites. Il fit surveiller très étroitement l’armée, ses idées politiques, sa religiosité, sa discipline, faisant baisser considérablement le moral des forces armées. Pour tout, il s’appuya sur les forces catholiques réactionnaires. Il fit pourtant quelques réformes : enseignement primaire gratuit dans toutes les communes et ouvert aux filles, mais confié aux prêtres avec catéchisme obligatoire ; encouragement de la diffusion de l’instruction par une presse populaire (la « Bibliothèque populaire » lancée en 1828 par l’éditeur Pomba) : tribunaux avec une magistrature salariée sur le modèle napoléonien. C’est par ailleurs une période de croissance économique : la population passe à 2.481.000 habitants, développement du réseau routier, réalisation de la première Exposition Universelle de Turin en 1829, rénovation de Turin (Places Vittorio Veneto e Carlo Felice, Musée Égyptien), modernisation des industries de la laine et du coton. Son règne est donc un mélange de régression idéologique et de vitalité économique.

À la mort de Charles Félix en avril 1831, c’est Charles Albert qui devient roi : par absence d’héritiers mâles de Charles Félix, la royauté passe à une autre branche des Savoie, celle des Savoie-Carignano qui descendent de Thomas, le dernier fils de Charles Emmanuel I. Cette branche, dont un des membres fut le prince Eugène, grand chef de guerre vainqueur des Français en 1706, était très liée à la France et sensible aux Lumières et parfois à la religion réformée ; pendant la période napoléonienne, le père de Charles Albert s’était mis au service de la France, et la mère de Charles Albert avait fait l’éducation de son fils et de sa fille entre la France et la Suisse ; on l’appelait « la princesse jacobine », et Charles Albert était passé dans un collège de Genève tenu par un pasteur calviniste. En 1821, il prend le parti des insurgés, et, malgré l’opposition de l’Autriche, il accède au trône en 1831, après avoir tenté de se refaire une virginité politique en participant à la répression d’un mouvement libéral en Espagne en 1823. Il sera donc objet de méfiance aussi bien des libéraux qui le considèrent comme un traître que des conservateurs qui le croient jacobin ! Et ses décisions oscilleront entre les deux : il refuse l’amnistie politique mais appelle au gouvernement des libéraux, il renforce la répression contre le mouvement de la «Jeune Italie » de Mazzini, fait des concessions aux Jésuites, mais il promulgue de nouveaux codes civil et pénal inspirés de la pensée napoléonienne, et soutient le progrès de l’économie (il libère par exemple le commerce des barrières douanières et favorise la 4e Exposition d’industrie nationale de Turin en 1844) et de la culture. Son règne sera donc aussi un mélange contradictoire de maintien d’un État conservateur et de poussée de progrès et de pensée libérale (Cesare Balbo, Massimo d’Azeglio, Vincenzo Gioberti …). Cela laissera mûrir les conditions pour que les intérêts dynastiques des Savoie rejoignent les exigences du « Risorgimento » et fassent du Piémont le guide de l’unification italienne.En juin 1846, est élu pape Giovanni Mastai Ferretti, sous le nom de Pie IX, et il semble ouvrir une porte à une politique libérale, en proclamant aussitôt une amnistie politique. Cela libère les soucis religieux de Charles Albert, et il approuve les initiatives d’assistance de la marquise Giulia Falletti di Barolo, du chanoine Cottolengo (la Petite Maison de la Divine Providence) ou du jeune don Bosco avec ses oratoires pour les enfants des rues. Il fait appeler le jeune Camille Cavour, considéré comme un « carbonaro impénitent » à la Commission Supérieure de Statistiques, il appelle le pédagogue Ferrante Aporti, haï par les ecclésiastiques pour former les futurs maîtres. En 1848, la population atteint 2.758.000 habitants, l’éclairage au gaz est installé en 1837 à Turin, qui se développe très rapidement, atteignant 137.000 habitants en 1848, dont 62% des hommes et 40% des femmes savent lire et écrire. Pourtant la situation des ouvriers reste très dure, environ 20% de la main-d’œuvre est constituée d’enfants mineurs, et les conflits se multiplient avec les patrons.
C’est au Piémont que s’impriment les oeuvres des patriotes libéraux, et que prend forme l’idée d’une lutte pour une Italie unie sous la direction de la famille de Savoie. Charles Albert est conscient de cette évolution et en 1847, il promeut un certain nombre de réformes importantes, réduit la censure et les pouvoirs de la police, licencie ses ministres réactionnaires, institue les Cours d’Appel et de Cassation, réforme les administrations communales par élection directe des conseillers sur base censitaire, développe l’instruction universitaire d’État. Ainsi, il isole la Droite réactionnaire et l’archevêque de Turin au profit de partis libéraux et démocrates, et il concède finalement une Constitution qu’on appellera le « Statut », qui s’inspire de la constitution de Louis-Philippe en 1830, rédigé en français et en italien, et qui sera la constitution de l’Italie jusqu’au fascisme (Cf tapisserie ci-dessus : Charles-Albert signe le Statut). Il adopte le drapeau tricolore vert, blanc, rouge assorti dans le blanc de la croix de Savoie.


Le Statut déclare la religion catholique « religion d’État », les autres cultes étant « tolérés », il reconnaît la liberté d’association et de réunion, introduit un Parlement à deux chambres, Sénat nommé et Chambre des députés élue au suffrage censitaire par collège uninominal (= 1,88% de la population pour les élections politiques et 6,27% pour les élections administratives). C’était une reconnaissance, encore partielle, des principes libéraux et une marginalisation des réactionnaires. Le Parlement se réunit au Palazzo Carignano (Cf photo page précédente) ; les nobles n’y sont que 32 sur 204 ; l’ensemble est une majorité modérée, libérale, de droite ou de gauche, selon les régions du Piémont.
Le 22 mars 1848 éclate l’insurrection antiautrichienne de Milan (les « Cinq journées de Milan »), et cela décide Charles-Albert à déclarer la guerre à l’Autriche, ce sera la première guerre d’indépendance. L’armée piémontaise n’est pas encore bien organisée, malgré la création des « bersaglieri » en 1836, infanterie légère, et le renforcement de l’artillerie encore insuffisante. Mais Charles-Albert ne veut pas laisser l’initiative de la lutte pour la libération de l’Autriche aux libéraux démocrates de Milan, il fait donc preuve d’une audace qui sauvera dans l’avenir la monarchie de Savoie. L’entrée en Lombardie est triomphante (victoires de Goito et Pastrengo), et le maréchal Radetzky se réfugie dans le Quadrilatère des forteresses de Vénétie. Peschiera tombe, mais Radetzky reçoit des renforts et gagne la bataille de Custozza le 25 juillet. Charles-Albert se retire, abandonne Milan et signe un armistice le 9 août (armistice de Salasco, du nom du général chargé de la signature). Il reprend les hostilités au printemps 1849 et subit une défaite définitive à Novara le 23 mars, malgré les nombreuses révoltes populaires qui éclatent dans beaucoup de villes ; le soir même il abdique au profit de son fils Victor Emmanuel II et part en exil au Portugal où il meurt le 28 juillet. L’Autriche ne pousse pas son avantage pour ne pas trop affaiblir le roi, elle a compris que maintenant l’opposition n’est plus entre absolutisme et libéralisme mais entre libéraux modérés (Cavour, D’Azeglio) et radicalisme démocratique (Mazzini, Garibaldi).


Cavour entre au gouvernement en 1850 comme ministre de l’agriculture et du commerce puis passe aux finances en 1852 ; il devient chef du gouvernement en 1852. Il promeut une politique de développement économique qui marquera le triomphe de la bourgeoisie des entrepreneurs : il libéralise les échanges internationaux (le libre échange est sa doctrine de base), soutient les entrepreneurs avec l’aide de l’État, augmente les impôts fonciers et les impôts directs, renforce l’armée, n’hésite pas devant des investissements qui aggravent le déficit de l’État, développe les chemins de fer (935 kms en 1860), commence les travaux pour le canal Cavour en 1853 et pour le tunnel du Fréjus en 1857 ; depuis 1851, les leçons universitaires sont en italien et non plus en latin, et il crée en 1858 les écoles de formation des maîtres ; il fait adopter le système métrique décimal.
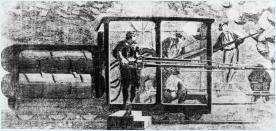

Cette politique se traduit par un renforcement de la classe ouvrière qui émerge peu à peu des vieilles corporations artisanales qui sont abolies dès 1844 ; naissent les premières sociétés ouvrières qui font leur premier congrès en 1851 (115 sociétés en 1861) ; les premières coopératives ouvrières fournissent des aliments à bas prix. La surveillance policière des activités ouvrières est renforcée, la grève est un délit. Mais Cavour est conscient que pour éviter le socialisme, il faut améliorer les conditions de vie et de travail de la classe ouvrière.La politique de Cavour provoque aussi un conflit avec les parties les plus réactionnaires de l’Église : le développement de l’école publique est combattu par Fransoni, l’archevêque de Turin et par les Jésuites. En 1849, la loi Siccardi supprime les tribunaux ecclésiastiques et contrôle les dons aux sociétés religieuses. Cette loi est commémorée par l’obélisque de la place Savoia de Turin avec la mention : « La loi est égale pour tous ». L’archevêque Fransoni, qui avait appelé le clergé à ne pas obéir à la loi, est arrêté, emprisonné et exclu du Royaume. La loi Rattazzi, de mars 1855, supprima les congrégations religieuses qui n’avaient pas d’objectif d’assistance ou d’enseignement (331 couvents sont supprimés), suscitant une hostilité hystérique d’une partie du monde catholique, mais la majorité de ce Piémont très catholique fut plutôt contente d’être débarrassée de Fransoni.


Cavour et Victor Emmanuel II se détestent et sont opposés sur la politique religieuse, mais ils sonr d’accord sur la politique étrangère. Ils ont consacré une grande attention à la réforme de l’armée confiée au jeune général Alfonso La Marmora, ministre de la guerre de 1849 à 1860 ; il renforce les écoles militaires, développe la cavalerie légère et les bataillons de « bersaglieri » ; on modifie la conscription, réformant 37% de chaque classe pour insuffisances physiques (taille inférieure à 1m.56) et 23% pour motifs de famille (fils unique d’une mère veuve ou d’un père âgé) ; les autres sont pris pour un service de 5 ans plus 6 ans de réserve. L’armée était ainsi de 46.000 hommes, qui pouvaient tripler par le rappel des réservistes. Il était possible de se payer (très cher) un remplaçant.
La première épreuve fut la participation à la guerre de Crimée en 1855 : Cavour envoie 18.000 hommes contre la Russie, aux côtés des Turcs, de la France et de l’Angleterre. Elle ne coûte que 15 morts à l’armée piémontaise dans la bataille de la Cernaia, mais permit à Cavour de développer ses relations diplomatiques avec la France et de parvenir en 1858 aux accords de Plombières par lesquels la France s’engageait à aider le Piémont en cas d’attaque de l’Autriche, en échange du rattachement de la Savoie et du comté de Nice à la France. La comtesse de Castiglione, Virginia Oldoini, aurait par ses charmes aidé Cavour à convaincre Napoléon III ! Par ailleurs Victor Emmanuel II marie sa fille Maria Clotilde di Savoia à Jérôme Bonaparte. Dans son discours du 1er janvier 1859, Victor Emmanuel II évoque le « cri de douleur » qui monte vers lui de l’Italie contre l’oppression autrichienne, et il mobilise aussitôt l’armée, grossie d’un corps de volontaires italiens commandé par Garibaldi. L’Autriche tombe dans le piège et demande le désarmement, Cavour refuse et l’Autriche attaque le 26 avril et envahit le Piémont, ouvrant la Seconde guerre d’indépendance, Mais la contre attaque franco piémontaise repousse les Autrichiens et remporte la bataille de Magenta le 4 juin 1859, après laquelle Victor Emmanuel II et Napoléon III entrent à Milan. Le 24 juin se déroule les batailles de San Martino, la plus sanglante de la guerre, et de Solferino, victoires franco piémontaises dont les 40.000 victimes portèrent Henry Dunant à fonder la Croix Rouge. Ces victoires provoquèrent l’insurrection de la Toscane, de la Romagne, des Marches, de l’Ombrie et des duchés de Parme et de Modène. Inquiet de ces mouvements républicains dans l’Italie centrale, Napoléon III arrête la guerre et signe avec l’Autriche l’armistice de Villafranca le 11 juillet 1859 Garibaldi organise alors l’expédition des Mille qui part de Quarto près de Gênes avec l’accord secret de Cavour, débarque à Marsala en Sicile et conquiert l’île sur les troupes du roi de Naples François II. Puis il débarque en Calabre le 20 août et entre triomphalement à Naples le 7 septembre. Une insurrection dans les États du pape offre à Cavour l’occasion d’intervenir en Italie centrale, et les troupes royales occupent les Marches et l’Ombrie et défont l’armée pontificale à Castelfidardo le 18 septembre. Garibaldi remet le Sud de l’Italie au roi le 22 octobre et se retire à l’île de Caprera. Le 17 mars 1861, lors de la réunion du premier parlement au palais Carignano, Victor Emmanuel II est proclamé roi d’Italie et 10 jours plus tard Rome est déclarée capitale, mais ne le deviendra réellement que le XX septembre 1870. En attendant la capitale reste à Turin.

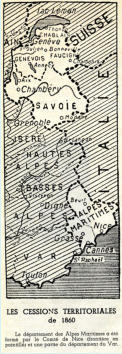
11) De l’unité italienne à la première guerre mondiale
L’unité de 1861 fut pour le Piémont à la fois une perte et une conquête. Une perte parce que la région cessait d’avoir un rôle politique central, pour devenir plus périphérique. Turin fut d’abord capitale, mais en 1864, la capitale fut déplacée à Florence, et Turin perdit la cour, les ministères, les ambassades, la banque centrale, l’hôtel des monnaies, et sa population baissa de 220.000 à 194.000 habitants. En 1864, les Turinois protestèrent pacifiquement contre ce transfert de la capitale, et leurs manifestations furent durement réprimées par l’armée, au coût de 50 morts et 134 blessés. Turin se sentit abandonnée et rejetée.
Mais parallèlement, le Piémont s’étendit à l’Italie entière : la région transmit à la nouvelle Italie ses lois, ses impôts, ses institutions, son organisation militaire, sa classe politique royale, et cela renforça un fort sentiment antipiémontais complexe : méfiance démocratique vis à vis de la noblesse piémontaise, hostilité au service militaire obligatoire, mépris des humanistes contre la culture piémontaise plus scientifique et technologique, arrogance des bureaucrates piémontais, inadaptation des lois piémontaises à l’agriculture du centre et du sud de l’Italie, etc. Il est vrai que le Piémont fournit en particulier une armée à tout le pays : dans les années ‘60 et ‘70, un tiers des généraux et des aides de camp du roi étaient piémontais, et c’est cette armée qui réprima avec férocité le « brigandage » méridional.
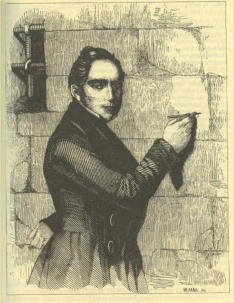
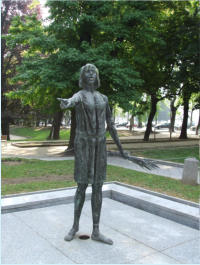
Cette situation fut cause d’un progrès de la gauche piémontaise qui connut un succès aux élections de 1865, où même un homme comme Angelo Brofferio, poète, écrivain et journaliste d’extrême-gauche fut réélu au Parlement ; les deux grands quotidiens turinois, la « Gazzetta del Popolo », anticléricale et garibaldienne, et la « Gazzetta piemontese », libérale éclairée, furent dans l’opposition au pouvoir central. Un homme politique comme Giovanni Giolitti (1842-1928), élu libéral piémontais, sera souvent le symbole de l’opposition piémontaise à la politique de droite du sicilien Francesco Crispi (1819-1901), ancien partisan de Mazzini rallié à la monarchie et à la droite. À partir de ce moment, l’électorat piémontais resta orienté à gauche pendant une grande partie du XXe siècle.
Après l’Unité, le Piémont resta une zone de petite propriété agricole, beaucoup plus que les autres régions italiennes, centrée sur la production de vin, de vers à soie, de fruits, bien introduite sur le marché. Sauf dans les zones de montagne, ce régime assure la vie des petits propriétaires, moyennant un travail très important et dur. Par contre, dans la région de Novara et Vercelli, le développement des rizières va de pair avec celui de plus grandes propriétés, plus mécanisées et travaillées par 40% de journaliers agricoles. Le souvenir de cette production se retrouve dans les grandes fermes (la « cascina ») des grands propriétaires cultivateurs de riz, et dans les chants de mondines importées chaque saison de Vénétie ou d’Émilie pour le repiquage et la récolte du riz.
L’élevage bovin continue à augmenter (de 500.000 dans l’Ancien Régime à un million en 1871). La mécanisation progresse partout, pour les semailles, la récolte du foin et les moissons. La déforestation est importante, et la surface des bois diminue au profit des terres cultivées : l’industrie, qui manque de charbon, a besoin de bois comme source d’énergie.
Au moment de l’unité, l’industrie piémontaise reste la plus développée d’Italie, et sa classe ouvrière la plus moderne et la plus organisée. la production de vers à soie représente un quart de la production nationale, et la soie reste un des secteurs les plus importants ; la production des tissus de laine et de coton constitue un tiers de la production nationale ; la mécanisation est forte dans le travail du coton, moins dans celui de la laine et de la soie. Le manque de charbon est un obstacle, que l’ouverture du tunnel du Fréjus en 1871 réglera en partie, permettant l’importation du charbon de Saint-Étienne, qui ne coûtait que 28 F. la tonne, contre 63 F pour le charbon de Cardiff importé jusqu’alors par voie maritime. Le marché de l’industrie textile reste centré sur le marché français (Lyon pour la soie) et les commandes militaires ; les producteurs de laine de Biella visent plutôt le marché intérieur italien, et sa valeur triple de 1854 à 1872.
Hors du textile, le Piémont travaille les produits chimiques (fertilisants), la tannerie, l’industrie alimentaire (Cirio fondée en 1836 à Turin) ; la mécanique représente l’avenir mais est encore limitée aux usines de produits ferroviaires et aux usines militaires. Les ouvriers de l’industrie sont en 1888 environ 140.000 sur une population de 3.179. 000 personnes. L’analphabétisme diminue lentement : en 1881, 63% des hommes et 47% des femmes savent lire et écrire : la population agricole se réduit à 40% ; la bourgeoisie l’emporte maintenant en richesse sur la noblesse qui, dans les années ‘80, ne possède plus que 33% des patrimoines supérieurs à 500.000 lires. Par contre, l’urbanisation reste moins importante que dans d’autres régions d’Italie : seulement 21% de la population habite dans des centres supérieurs à 6000 habitants. Les seules villes en expansion sont les villes industrielles, Alessandria (72.000 habitants en 1901), Novara (44.000 habitants en 1901) et Biella (19.000 habitants) ; les villes agricoles grossissent moins vite ; Asti (44.000 habitants), Casale (31.000 habitants), Vercelli (30.000 habitants), Cuneo (27.000 habitants). Turin prend une identité industrielle de plus en plus marquée : sur 194.000 habitants, la ville a 52.000 ouvriers, dont 21.000 femmes en 1864. En 1881, la population est montée à 253.000 habitants, dont 69.000 ouvriers (27%). Deux édifices symbolisent la ville : le sanctuaire de Santa Maria Ausiliatrice, centre du catholicisme social dans les quartiers ouvriers, et la Mole Antonelliana, rachetée en 1873 par la commune à la communauté hébraïque, et qui fut le plus haut édifice en maçonnerie de toute l’Europe d’alors.



A la fin du XIXe siècle, le Piémont connaît une forte crise agricole. Tous les produits, sauf le vin, connaissent une récession importante qui met la région en difficulté par rapport à la Lombardie, à la Vénétie et à l’Émilie, ainsi que dans ses relations avec la France. Mais, en particulier grâce au réseau associatif des paroisses (très développé : 347 coopératives en 1889), il y a peu de manifestations paysannes. Mais les paysans commencent à émigrer, en France d’abord, puis en Amérique, en Argentine, au Brésil. De 1876 à 1913, auraient quitté le Piémont 1.540.000 personnes, mais beaucoup rentrèrent après avoir gagné un peu d’argent. Beaucoup de communautés rurales d’Amérique du sud restent jumelées à la commune italienne d’origine. La reprise agricole ne se fera qu’au début du XXe siècle, avec la mécanisation, l’usage des fertilisants, en particulier dans la culture du riz. La production du vin se multiplie, dépassant 6 millions d’hectolitres, et exportant sur le marché français les vins comme le Vermouth, le Martini, l’Asti spumante ; le phylloxera atteint les vignes des petits propriétaires qui s’organisent et luttent pour obtenir des aides de l’État et de meilleures conditions de vie et de travail.
La crise est moins forte dans le domaine industriel : première Exposition Nationale de l’industrie en 1884, à Turin qui connaît aussi ses débuts d’éclairage électrique et la construction du Bourg Médiéval du Valentino. Il y a pourtant un crack immobilier et bancaire qui se traduit par des centaines de faillites et des taux élevés de chômage et de délinquance ; la masse des dépôts dans les caisses d’épargne est 5 fois moins importante qu’en Lombardie, en Émilie et en Vénétie ; la soie est touchée, elle souffre de la rupture commerciale avec la France ; au contraire le coton se développe, favorisé par les tarifs douaniers qui lui ouvrent le marché intérieur ; de grandes usines occupent jusqu’à 3000 ouvriers et le nombre de travailleurs de ce secteur monte à 33.000 ; le secteur est aussi prospère du fait qu’il dépend peu des banques mais vit d’investissements suisses et allemands (par exemple Leumann à Collegno). Au Parlement élu en 1890 figurent de nombreux industriels du coton, nouvelle classe politique bourgeoise qui remplace peu à peu la vieille noblesse. Cependant, l’augmentation de la production d’électricité d’origine hydrique était un avantage incontestable du Piémont. La production lainière occupe 15.000 ouvriers et représente 40% du total national ; le métier à tisser à énergie hydraulique puis électrique remplace peu à peu le métier à main, et détermine la formation d’une classe ouvrière moderne, qui supplante les anciennes corporations de tisseurs à domicile. En 1901, la classe ouvrière du Piémont est la troisième d’Italie, l’analphabétisme est en chute constante (17%) ; la mortalité a diminué de moitié en 30 ans ; la population de Turin est passée à 330.000 habitants.
Le mouvement ouvrier se développe, créant à Turin son Association Générale des ouvriers, avec ses 10.000 adhérents, la plus importante d’Italie ; de grandes grèves commencent à être organisées, et à la fin du siècle, le mouvement socialiste prend forme, malgré la répression policière contre les leaders et contre la presse, sous Crispi. Beaucoup d’intellectuels suivent le mouvement, comme Edmondo De Amicis (1846-1908), l’auteur de Cuore (1886), né en Ligurie mais étudiant à Turin, ou Cesare Lombroso (1835-1909) qui adhère au socialisme au Congrès de Gênes en 1892. En 1897, les votes socialistes montent à 27% et 2 députés sur 5 sont socialistes ; Alessandria est la première ville italienne à avoir un maire socialiste, l’ouvrier Paolo Sacco. En 1904, 1339 Sociétés de Secours Mutuel existent en Piémont, la plupart appartiennent au monde ouvrier. Un mouvement syndical moderne s’organise aussi, articulé en 17 Chambres du Travail. En face d’eux, s’organise une Ligue Industrielle à partir de 1906, qui réunit les propriétaires de 530 entreprises, et qui donnera naissance en 1910 à la Confindustria nationale, l’organisation patronale encore existante aujourd’hui. Les« metalmeccanici » furent les organisateurs des grandes grèves de 1901-02 qui obtiennent une diminution de la journée de travail à 10 heures, l’obligation d’un préavis pour le licenciement, la reconnaissance des commissions internes dans les entreprises. Contre les autres entrepreneurs Agnelli se bat pour une médiation de l’État et une ligne moins dure, et Giolitti condamne les patrons partisans d’une ligne dure et réalise les bases d’un contrat collectif avec les syndicats en même temps qu’une semaine de 57 heures. Par ailleurs Agnelli introduit dans ses usines les méthodes tayloristes importées d’Amérique : la production journalière passe de 10 à 25 voitures.


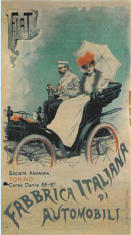
Sur un autre plan, Giolitti instaure le suffrage universel masculin, et Turin envoie au Parlement 3 députés socialistes sur 5. C’est à Turin qu’entrent au Parti Socialiste les hommes qui seront les fondateurs du Parti Communiste après la guerre, Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti, Angelo Tasca, Umberto Terracini.C’est sous Giolitti que le développement industriel du Piémont fut le plus fort, dans une convergence entre les libéraux giolittiens, les industriels et les socialistes réformistes, et avec l’appui de la Stampa, maintenant dirigée par Alfredo Frassati (100.000 copies par jour). Les services essentiels (eau, énergie électrique, tramways) sont municipalisés ; les écoles techniques pour ouvriers se multiplient, ainsi que les constructions sociales. La population de Turin passe à 415.000 habitants en 1911 ; les logements ouvriers développent d’immenses périphéries industrielles. C’est l’industrie mécanique, surtout automobile, qui prend le dessus, formant une base ouvrière bien préparée techniquement (on parle d’une « aristocratie ouvrière ») : la FIAT en 1899, d’abord productrice de voitures de luxe pour les loisirs aristocratiques, puis pour une utilisation plus large, enfin pour les besoins militaires pendant la première guerre mondiale. En 1911, la FIAT a plus de 3000 ouvriers.
n 1901, le Piémont a 342.000 ouvriers d’usine, 9,8% de la population totale ; les salaires étaient les plus hauts de toute l’Italie, et l’analphabétisme le plus bas (11% dans tout le Piémont, et 3,8% à Turin. Un certain nombre d’entreprises donnent son image au Piémont : Olivetti à Ivrea (créée en 1908, spécialiste des machines à écrire), Pirelli, la RIV de Villar Perosa, la Borsalino d’Alessandria, les Cartiere (papeteries) Burgo de Verzuolo, Lancia, Alfa Romeo, Itala, Michelin, Talmone …, sans parler de l’industrie du cinéma (14 sociétés de production et 40 salles en 1914), et des courses automobiles créées par Agnelli, ou du football (la Torino, la Juventus, la Pro Vercelli) : le premier championnat italien de football se joue à Turin en 1898.
12) Le Piémont de la première guerre mondiale à aujourd’hui
Depuis l’Unité, le roi a changé deux fois : Victor Emmanuel II meurt à l’improviste à Rome le 9 janvier 1878. Humbert I prête serment le 19 janvier 1878, il est assassiné le 29 juillet 1900 par l’anarchiste Gaetano Bresci à Monza, pour venger la répression violente d’une manifestation populaire pacifique de Milan par le général Bava Beccaris (plus de 300 morts et un millier de blessés). Le jeune Victor Emmanuel III prononce son discours de la Couronne le 11 août 1900 ; il régnera jusqu’à son abdication du 9 mai 1946 au profit de son fils Humbert II qui régnera jusqu’au referendum constitutionnel du 2 juin 1946 qui donnera la majorité à la République.
Le Piémont manifesta un hostilité populaire à l’entrée en guerre de l’Italie en mai 1915, qui provoque un mouvement de grève générale de protestation à Turin ; cependant la population piémontaise se plia à la discipline de mobilisation et subit de fortes pertes, 3% des hommes moururent à la guerre, en particulier dans la zone de Cuneo qui fournit les troupes alpines très engagées dans le conflit ; de plus la grippe espagnole provoqua 3000 morts rien qu’à Turin. C’est le monde paysan qui supporta de 60 à 70% des morts, mutilés et invalides, car les ouvriers avaient été exonérés de service militaire pour ne pas ralentir la production militaire, mais ils avaient été soumis à une discipline de fer, soumis au code pénal de guerre, avec un rythme de travail de plus en plus lourd. La protestation contre la guerre se renforça à partir de la révolution russe de 1917, les manifestations furent durement réprimées par l’armée à coups de mitrailleuses et de chars d’assaut, faisant 41 morts et 150 blessés ; plus de 1000 arrestations de militants décapitèrent les partis et syndicats dans la province de Turin. Cela accentua les conflits entre la Stampa favorable à Giolitti et aux socialistes réformistes accusés de pacifisme et la Gazzetta del Popolo favorable à l’intervention et à la répression des ouvriers « subversifs » et provoqua une campagne nationale de dénigrement de Turin giolittienne.
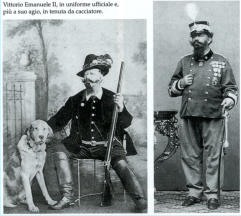


Cependant le Piémont profita de la guerre dans un premier temps, par les commandes de guerre dans la métallurgie, le textile et le coton ; Biella fournit les ¾ du drap vert de gris acheté par l’armée, et la FIAT passe de 4000 à 40.000 ouvriers ; Turin monte à 525.000 habitants en 1918, aux dépens des campagnes qui se dépeuplent, favorisant encore plus le développement de la petite propriété qui passe de 44% en 1911 à 65% en 1921, les grandes propriétés sont parcellisées et vendues à de petits propriétaires. Turin est un laboratoire de modernité économique et politique, la Chambre du Travail a plus de 100.000 inscrits et le journal socialiste l’Avanti tire à 50.000 exemplaires. La fin de la guerre marqua une retombée des commandes, du chômage et une émigration vers la France demandeuse de main-d’œuvre. Les syndicats obtiennent un régime de 8 heures de travail, et le mouvement socialiste se radicalise ; les socialistes gagnent les élections de novembre 1919 (63% à Turin, 70% à Biella).
Le Piémont fut ensuite en 1919-1920 le centre d’un important mouvement de conseils d’usine, expression de l'« Ordine Nuovo » publiée par les groupes de l’extrême-gauche du parti socialiste animés par Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti, Umberto Terracini, Angelo Tasca, Alfonso Leonetti. Les usines furent occupées, mais les travailleurs continuèrent à les faire fonctionner, à partir du 22 août, sous la protection de leurs « gardes rouges », qui disposaient des armes restées dans les usines après la fin de la production de guerre ; la grève conduisit à un accord national signé par les entrepreneurs et les syndicats, qui accordait beaucoup d’avantages au personnel (augmentations de salaires jusqu’à 20%, les fêtes payées, une indemnité de licenciement, etc), et qui fut encouragé par Giolitti. Mais le parti socialiste se méfiait de cette extrême-gauche qui d’ailleurs le quitta en août 1921 à Livourne pour fonder le Parti Communiste d’Italie. Et Turin fut un peu isolée par rapport au reste de l’Italie. Agnelli, qui était resté modéré pendant la période des conseils d’usine, et avait même eu l’habileté de proposer la transformation de la FIAT en coopérative, sortit vainqueur de l’épreuve ; aussitôt après il devint propriétaire de la Stampa, et en novembre 1920, les socialistes perdirent la mairie de Turin. Une autre revue avait engagé le dialogue avec l’Ordine Nuovo, Energie Nuove, remplacée par la Rivoluzione liberale, tendue vers une synthèse entre le socialisme de Gramsci et le libéralisme politique et dirigée par Piero Gobetti, assassiné par les fascistes et qui meurt à Paris en février 1926.
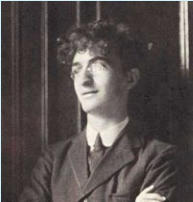

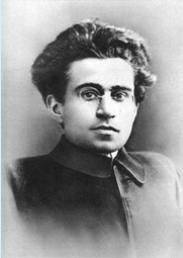
Préoccupés par le mouvement des conseils d’usine, les industriels piémontais financent les premières organisations de type fasciste, dirigées par le capitaine Mario Gobbi ; ces « fasci di combattimento » de « squadristi » furent actifs dans la destruction des locaux socialistes et l’agression ou l’assassinat de militants ouvriers et socialistes. Ainsi le fascisme prenait pied au Piémont fin 1920, début 1921, dirigé par Cesare De Vecchi (novembre 1884-juin 1959) et Piero Brandimarte ; il est encouragé aussi bien par la petite bourgeoisie frustrée après la guerre que par les propriétaires fonciers inquiets de possibles révoltes du prolétariat des journaliers agricoles. Cette montée du fascisme est parfois combattue par les préfets et les carabiniers (Alessandria) mais plus souvent aidée par la police qui avait été en conflit avec les « rouges » (Turin). Le sommet fut atteint dans l’été 1922 : dans la province de Novara, 221 administrations socialistes furent éliminées par les actions des « squadristi », des maires socialistes furent agressés, les locaux brûlés, 83 militants socialistes assassinés, agressions contre les lieux de distribution de la Stampa, etc., bien que les fascistes piémontais soient seulement environ 15. 000 contre 80 000 en Lombardie. Les violences fascistes se poursuivirent même après la marche sur Rome d’octobre 1922 et la prise de pouvoir de Mussolini à qui le roi, incapable de résister à un mouvement que l’armée aurait pu éliminer sans peine, confie la charge de premier ministre (Cf photo ci-contre : rencontre de Victor Emmanuel et de Mussolini en 1922). Pendant 20 ans, il se rendra ainsi complice du régime fasciste : il reçoit Mussolini deux fois par semaine, approuve toutes ses décisions (entreprises coloniales, participation à la guerre civile espagnole d’Espagne aux côtés de Franco, lois raciales, entrée en guerre …) ; et, bien qu’étranger au style du fascisme, il ne laissera jamais apparaître aucune distance entre la royauté et le régime. Le roi ne se séparera de Mussolini que le 24 juillet 1943, lorsqu’il aura compris que sa politique conduit à la ruine l’Italie et la monarchie : Mussolini est arrêté par le Grand Conseil Fasciste, le roi signe l’armistice avec les Alliés le 8 septembre 1943 et s’enfuit de Rome vers Brindisi. Il abdique le 9 mai 1946 au profit de son fils Humbert II, qui restera roi jusqu’au referendum du 2 juin de la même année. Puis Victor Emmanuel émigre en Égypte où il mourra le 28 décembre 1947. Humbert II quitte l’Italie le 15 juin pour le Portugal tandis que la reine Maria José se retirera en Suisse ; exilé par la Constitution républicaine qu’il n’a pas reconnue, Humbert II mourra exilé le 18 mars 1983 et sera enterré à l’abbaye d’Hautecombe ; il avait fait cadeau au Vatican du Saint Suaire de Turin. Il laisse 3 filles et un fils, Victor Emmanuel, né en 1937, compromis dans diverses affaires judiciaires dont une d’incitation à la prostitution, et dont le fils, Emmanuel Philibert a tenté une carrière de danseur avant de se lancer dans la chanson au Festival de Sanremo de 2010. Triste fin d’une dynastie de dix siècles d’existence !


Au Piémont, Mussolini oscilla entre légalité et extrémisme fasciste des « squadristi », mais c’est le modéré Cesare De Vecchi qui garda presque toujours le pouvoir. Car le fascisme dut toujours tenir compte de la puissance de la famille Agnelli et du souci de celle-ci de garder le contrôle et de l’économie et de la Stampa combattue par la Gazzetta del Popolo dont Mussolini avait acquis le contrôle financier. Un relatif équilibre politique finit par s’établir entre le pouvoir fasciste et la famille Agnelli qui jouait une carte nationale, ignorant souvent les pouvoirs locaux.
La liquidation des cadres syndicaux et socialistes et la promotion d’un syndicat fasciste permit à Agnelli de développer tranquillement les techniques tayloristes et l’organisation scientifique du travail, faisant faire un bond à l’industrie mécanique qui attire vers le Piémont une importante main-d’œuvre immigrée de Vénétie, Sicile et Pouilles, qui s’entasse dans les nouveaux quartiers qui poussent autour du Lingotto et de la Snia Viscosa. Mais la crise de 1929 vint frapper tous les secteurs ; l’agriculture (prix du riz, de la soie grège, du vin, qui s’écroulent, provoquant un chômage des journaliers) et l’industrie (salaires réduits de 15%, 50.000 chômeurs, expulsion du logement, etc.). La FIAT résista pourtant mieux que les autres, grâce à ses contrats avec l’Union Soviétique. Et à la fin des années Trente, le Piémont avait retrouvé sa richesse, il avait le plus haut revenu national, dont il représentait 13,5%. L’industrie représentait 52% de ce revenu, l’agriculture 24% et les services tertiaires 24%. Quelques grandes industries, dont la FIAT (57.000 ouvriers et bientôt 22.000 de plus avec la construction de l’usine Mirafiori) occupaient une place de premier plan en Italie, la Snia Viscosa, Michelin, Olivetti, Cotonificio Valle di Susa, Burgo, etc.
Jusqu’en 1929, le fascisme eut beaucoup de peine à obtenir un consensus aussi bien des industriels que des ouvriers, qui restaient marqués par leur tradition de syndicalisme révolutionnaire animé par les militants communistes, et Agnelli s’opposa toujours à la pénétration du syndicat fasciste dans son entreprise. Les choses se stabilisèrent un peu avec la crise de 1929 qui affaiblit la résistance des industriels et réduisit la classe ouvrière à la misère ; or le régime tenta d’aider les entreprises et de créer des œuvres d’assistance pour les chômeurs et mendiants ; il ouvrit aussi des travaux publics pour réduire le chômage, autoroute Turin–Milan, constructions à Turin (Torre Littoria), réhabilitation des petites villes de province (le vin à Asti). Par ailleurs le syndicat fasciste s’opposa vigoureusement à l’augmentation de la productivité et des rythmes du travail, mesurés scientifiquement (méthode Bedaux) ; le régime élargit sa politique sociale, par des institutions pour les ouvriers (le « dopolavoro »), pour les jeunes (les « balilla »), en accordant des allocations familiales, des crèches, la semaine de 40 heures, le « samedi fasciste ». Au début des années 30, plus de la moitiés des ouvriers avait adhéré au syndicat fasciste, et le Parti National Fasciste avait 89.000 adhérents dans la classe moyenne, mais ces adhésions étaient dépourvues de tout enthousiasme et de toute conviction ; la remontée du prix du riz permit de mieux traiter les milliers de mondines qui se déversaient au Piémont chaque année ; mais en profondeur, le Piémont fut peu fasciste, l’antifascisme était toujours prêt à se manifester, et en 1940 le Tribunal de Turin prononça 2172 condamnations pour propagande antifasciste.


Le Piémont fut défavorable à l’entrée dans la seconde guerre mondiale ; les commandes militaires ne furent pas aussi nombreuses qu’en 1915, la population était favorable à la France, contre qui la campagne de juin 1940 fut meurtrière pour les Italiens (6000 morts ou blessés contre une centaine du côté français) ; les bombardements frappèrent durement Turin et les centres ferroviaires, et à partir de mars 1943, les ouvriers recommencèrent à faire des grèves antifascistes qui bouleversèrent l’industrie. Les industriels entreprirent des contacts avec des personnalités communistes ou alliées pour se détacher du fascisme ; Agnelli et Valletta rétablirent les commissions internes que le fascisme avait supprimées en 1926.
À partir de l’armistice du 8 septembre 1943, les nazis occupent la totalité de l’Italie, et commencent à se former les groupes de partisans armés pour lutter contre l’armée allemande. Le Piémont fut en première ligne, et dès novembre, les groupes piémontais formaient déjà 40% des groupes armés de toute l’Italie. D’une zone à l’autre, l’orientation politique des formations était différente ; dans certaines vallées dominèrent les antifascistes libéraux de tradition gobettienne qui montèrent des villes vers la montagne avec les membres du nouveau Partito d’Azione pour former les bandes de « Italia libera » puis de « Giustizia e Libertà » (Duccio Galimberti, Dante Livio Bianco, Willy Jervis, ingénieur vaudois, Vittorio Foa et Franco Venturi, les frères Acchiardo, Ada Gobetti ; ils faisaient preuve d’une profonde politisation et d’une grande rigueur éthique). D’autres groupes étaient formés de militants communistes, avec le philosophe Ludovico Geymonat, Giancarlo Pajetta, Leo Lanfranco, Antonio Giolitti, ou avec d’anciens officiers comme Pompeo Colajanni, « Cino » Moscatelli ou « Ciro » Gastone. Quelques bandes furent monarchistes et conservatrices, commandées par des officiers de carrière (Enrico Martini, le sergent Maggiorino Marcellin, Eugenio Cefis) qui recrutaient parmi les soldats de la Quatrième Armée qui s’étaient débandés après le 8 septembre et ne voulaient pas abandonner les armes.
Les Waffen-SS réagirent aux interventions de ces formations par des représailles sur les civils, en brûlant les villages (à Boves), en ratissant les vallées et en faisant la chasse aux Juifs dont plusieurs centaines furent déportés. Les rapports entre les groupes partisans de différentes orientations furent parfois difficiles, entre groupes communistes et groupes de « Giustizia e Libertà », mais ils se partagèrent souvent pacifiquement les zones de combat. Dès le début, les groupes s’entendirent pour former un CLN, Comité de Libération Nationale, dont le sommet était formé de généraux (Operti, puis Perotti, fusillé par les nazis, puis Trabucchi).
Dès la création de la République Sociale de Salò par Mussolini (arrêté par le roi le 25 juillet 1943 et libéré par un commando SS le 12 septembre), l’Italie entra dans une terrible période de guerre civile entre les « repubblichini » alliés aux troupes allemandes et les formations antifascistes. Les Allemands réagirent avec violence aux actions partisanes, ils devaient conserver l’accès aux cols des Alpes et des Apennins pour pouvoir répondre à un éventuel débarquement allié en Ligurie ou en Toscane : ils fusillaient nombre de partisans et de civils, laissant leurs cadavres pendus aux arbres des places pour impressionner les habitants ; ils brûlèrent plusieurs villages : Barge, Paesana, Cartignano, San Damiano, Cicogna, Val de Thures … Mais les groupes partisans résistèrent et parvinrent à se réorganiser, constituant le CLNAI, Comité de Libération Nationale de la Haute Italie, qui regroupait environ 28.000 hommes sous les armes, et qui libéra et géra de nombreuses communes du Piémont : l’occupation des vallées prit une grande importance stratégique après le débarquement allié en Provence en août 1944 pour empêcher les troupes allemandes du Piémont de passer les Alpes vers la France (bataille du col de la Madeleine).
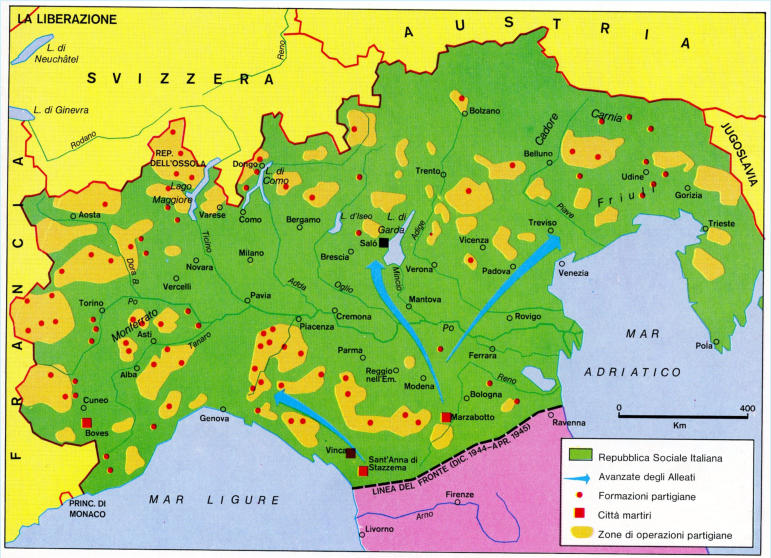

La Résistance italienne tint immobilisée la moitié des unités allemandes d’Italie du Nord, mais l’offensive allemande menée par Kesselring pour la reconquête des vallées contraignit la Résistance à se replier vers les collines et la plaine pendant l’hiver 1944-45, après lequel les Alliés multiplièrent les fournitures d’armes parfois lourdes et de munitions qui permirent aux partisans de reprendre l’offensive.
L’adhésion des populations à la Résistance fut différente selon les zones du Piémont. Dans celle de Cuneo, l’adhésion, loin d’être unanime, fut forte, car c’était une région de tradition ntifasciste et libérale ; Biella fut une autre zone très antifasciste, mais sur une base ouvrière influencée par les traditions de lutte syndicale et communiste. Turin fut très touchée par les bombardements alliés (2000 civils tués, et 40% des édifices de la ville atteints par les bombes), mais en donna toujours la responsabilité au fascisme ; par ailleurs les GAP Groupes d’action patriotique) y furent actifs, tuant plusieurs responsables fascistes ou des officiers allemands ; ce fut aussi la ville où, dès l’automne 1943, les ouvriers commencèrent à faire es grèves, interdites par les Allemands et sources de représailles brutales (700 ouvriers déportés après celles de mars 1944), mais prirent très vite une signification politique. Les rèves sont souvent lancées en accord avec la direction de la FIAT, qui les organise avec les ouvriers et les coordonne avec les bombardements américains pour empêcher les Allemands de ransférer en Allemagne les installations industrielles (grève et bombardement du 22 juin 1944). L’ensemble de la bourgeoisie industrielle était loin d’être favorable à la Résistance, mais s’y rallia peu à peu, sachant qu’elle avait le soutien des Alliés contre un fascisme discrédité et sous la coupe des Allemands ; l’exemple de la rencontre entre l’industriel Chevallard et les partisans de la Val Sangone est significatif. Enfin la tradition militaire piémontaise fit que beaucoup d’officiers s’intégrèrent dans les groupes de partisans par patriotisme et ostilité à l’occupant allemand, plus que dans les autres régions d’Italie. Malgré les représailles allemandes, les paysans gardèrent une attitude de soutien au moins passif des partisans antifascistes. Cela obligea la République de Salò à envoyer des brigades lombardes au Piémont pour remplacer l’absence de fascistes locaux (par exemple l’envoi, qui fut un échec, des rigades Noires de Pavolini et du Prince Borghese dans la Valle di Lanzo et la Valle dell’Orco). Mussolini qualifia le Piémont de « Vendée monarchique, réactionnaire et bolchevique » ; les fascistes se maintenaient avec peine dans de rares villes comme Vercelli, mais les rizières des alentours sont aux mains des partisans, et à la fin, les Brigades Noires restées au Piémont furent induites à se rendre aux Américains plutôt qu’aux partisans et plutôt que de tenter le retour en Lombardie, dont la route était contrôlée par la Résistance.
Dans les premiers mois de 1945, les Allemands se livrent à leurs dernières représailles par des villages brûlés, des partisans torturés (massacres de Grugliasco, Santhià, Caluso, Cuneo) et des Juifs déportés ou fusillés, mais ils commencent à tenter de traiter avec les responsables partisans en vue de se garder une possibilité de fuite vers l’Allemagne. Le CLN a prévu l’organisation de tribunaux de partisans qui n’ont le droit de condamner à mort que des fascistes pris les armes à la main, les autres ne pouvant être jugés que pour des crimes spécifiques ; cela n’empêcha pas les opérations de vengeance des dernières et féroces représailles allemandes et fascistes : environ 2500 fascistes furent exécutés, le chiffre le plus élevé de toutes les régions italiennes. Même après la Libération, et la reprise de la justice par la magistrature ordinaire, les tribunaux piémontais furent plus durs que les autres : environ 3600 personnes furent condamnées pour collaboration avec les Allemands, dont 203 à mort, dont seulement 18 exécutées. ; il n’y eut par la suite qu’une centaine de fascistes assassinés par des partisans, dont 5800 avaient été exécutés par les fascistes.
L’après-guerre jusqu’à nos jours commence par le referendum du 2 juin 1946. Le 9 mai 1946, pour tenter de sauver la monarchie, Victor Emmanuel III abdique au profit de son fils Humbert II. Cela ne convainc pas le peuple italien, qui vota en faveur de la République par 12.717.923 voix contre 10.719.284 à la monarchie sur 24.946.942 votants (89,1% des inscrits). La République est proclamée le 10 juin suivant. Enrico De Nicola est élu Président de la République ; le gouvernement dirigé par Alcide De Gasperi est mis en place, comprenant la Démocratie Chrétienne, le Parti Communiste Italien, le Parti Socialiste Italien d’Unité Prolétarienne et le Parti Républicain Italien. Le Traité de Paris du 10 janvier 1947 rectifie quelques frontières italiennes et fait perdre quelques territoires au Piémont (Cf carte ci-dessous). Humbert II ne reconnaît pas les résultats du referendum et quitte l’Italie pour le Portugal le 13 juin. La constitution républicaine appliquée à partir du 1er janvier 1948 interdira le séjour, mort ou vif, de tout membre mâle de la famille de Savoie.

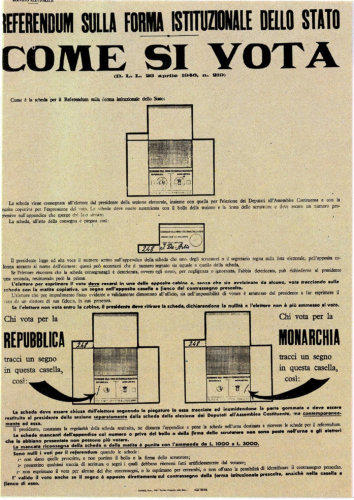
La Fiat et quelques autres grandes industries du Piémont bénéficieront de 25% des financements donnés à l’Italie par le Plan Marshall. L’industrie automobile est favorisée et la Fiat connaîtra une expansion continue pour atteindre un personnel de 158.000 employés en 1968 et à une production de 1.452.000 véhicules, soit 6% du marché mondial.
Dans les années ‘50, le mouvement syndical connut une forte offensive du patronat dans les entreprises ; la FIAT, – dirigée par Valletta, de la mort de Gianni Agnelli en décembre 1945 à la remise du pouvoir à Gianni Agnelli II en 1966 –, fut la pointe de cette attaque réactionnaire, les syndicalistes, surtout ceux de la CGIL, furent marginalisés, souvent licenciés, contrôlés par la police pour leur « conduite morale » et pour leur appartenance politique ; le directeur des services sociaux, Santhià, fut licencié parce qu’il était membre du Parti Communiste ; en mars 1952, la FIAT promit un supplément de 2000 lires à ceux qui ne feraient pas la grève de mars. Les syndicats « jaunes » liés au patronat l’emportent sur la FIOM-CGIL et obtiennent la majorité à la Commission Interne en 1958
Les années ‘60 verront une reconquête de la FIOM, en liaison avec le mouvement étudiant qui se manifeste dès le début de 1967. Le miracle économique et l’arrivée de milliers d’immigrants jeunes venus du Sud, moins résignés à la discipline rigoureuse et aux rythmes de travail, ouvrent une période de protestation ouvrière et de contestation, qui va souvent, contre le gré du PCI et des syndicats, jusqu’à l’appui d’entreprises terroristes des Brigades Rouges ou d’autres groupes d’extrême-gaucheDans les années ‘70, après la pointe de 1973 (1.628.000 véhicules produits), la Fiat transforme encore sa technologie par la robotisation (l’usine Mirafiori atteint 50.000 ouvriers en 1970) et la disparition des chaînes de montage traditionnelles où la conflictualité était la plus dure, et répond à la contestation par une politique de licenciements (61 ouvriers accusés de violence en 1979, 14.000 licenciés par Cesare Romiti en 1980 et envoyés en « Cassa integrazione », le mécanisme d’assistance qui prévoit la suspension du travail des ouvriers en excédent avec un salaire partiel payé par l’État). Le syndicat réagit en occupant la Mirafiori, mais est désavoué par la « Marche des 40.000 » du 14 octobre 1980. (Cf. photo à gauche), ouvriers souvent venus du Sud qui se déclarent solidaires avec l’entreprise. C’est une défaite pour la classe ouvrière turinoise, qui provoque entre autres 80 suicides de militants.

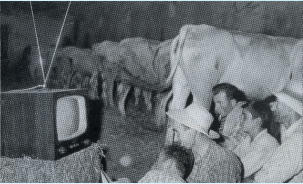
L’envers du développement de l’industrie et de la croissance de Turin (1.200. 000 habitants en 1961) est la dégradation de l’agriculture, sacrifiée à l’industrie, et l’exode des campagnes. De 1951 à 1961, l’agriculture passe de 32% à 23% de la population active, provoquant soit un dépeuplement dans les zones les plus pauvres (Cuneo) soit la création d’ouvriers-paysans. En 2006, les agriculteurs sont réduits à 3,6% de la population active, malgré les progrès technologiques et l’action d’un mouvement comme « Slow Food » de Carlo Petrini.
Par contre la croissance industrielle a provoqué un mouvement d’immigration interne : 800.000 immigrés de 1951 à 1969, dont la moitié à Turin, venus de Vénétie, de Pouilles, de Sicile et de Calabre. Cela est à l’origine d’une transformation rapide de la société piémontaise, d’où le racisme n’est pas absent, surtout après l’arrivée plus récente de roumains et autres habitants d’Europe centrale.
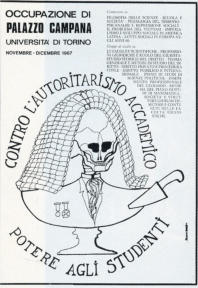
Il faut signaler encore un phénomène qui a été parfois dramatique dans les années 70 et 80, le terrorisme « rouge », qui assassine plus de 20 personnes entre 1975 et 1982. Les premières Brigades Rouges se concentrent d’abord sur la Fiat, la plus grande industrie italienne, dirigées par Renato Curcio, Mara Cagol et Alberto Franceschini ; en 1972, ils s’attaquent aux militants du parti néofasciste et du syndicat « jaune », la CISNAL, puis ils séquestrent Ettore Amerio, chef du personnel de Fiat Auto. L’antiterrorisme, dirigé par le général Dalla Chiesa, arrête ces premiers dirigeants en 1974 ; en 1975 un commando dirigé par Mara Cagol libère Curcio de sa prison et séquestre un industriel, Vallarino Gancia ; dans le conflit qui l’oppose à la police sont tués un carabinier et Mara Cagol. S’ensuivent les procès et le durcissement des Brigades Rouges qui « haussent le tir », aux jambes (des dizaines de blessés de 1976 à 1980) puis à la tête (homicides de l’avocat Fulvio Croce, médaille d’or de la Résistance et président de l’Ordre des Avocats de Turin, de Carlo Casalegno, directeur adjoint de la « Stampa », de l’adjudant Rosario Berardi, expert de l’antiterrorisme, de 4 agents, d’un dirigeant de la Lancia). Un autre commando terroriste, « Prima Linea », prend la suite des BR, avec des groupes comme les « Nuclei Comunisti Territoriali », jusqu’à la fin de ce phénomène en 1982.
Les élections politiques ont manifesté un partage du Piémont en deux zones, avec une majorité communiste et de gauche dans les parties industrielles (Turin – Novara,– Vercelli) et une majorité conservatrice démocrate-chrétienne dans les parties rurales (Cuneo – Asti – Alessandria). Après les années ‘80, la DC décline, le PCI prendra le dessus, conquérant plusieurs grandes villes et la direction de la région en 1975, puis il se transformera en PDS puis en DS, assurant la promotion d’une grande culture progressiste. Quelques écrivains marqueront la vie culturelle de la région : Cesare Pavese, Leone Ginsburg, Franco Antonicelli, l’éditeur Frassinelli (Cf photo ci-contre), et bien d’autres, Natalia Ginsburg, Primo Levi, Fruttero et Lucentini, Carlo Levi, Mario Soldati, Lalla Romano, Norberto Bobbio, Giovanni Arpino, Alessandro Baricco, etc. avec quelques grandes maisons d’édition, comme Tallone, l’UTET, Einaudi, Bollati, Paravia, Petrini, Loescher … Turin est chaque année le siège d’une des plus importantes Foires Internationales du Livre d’Europe, et le Piémont organise le prestigieux prix littéraire de Grinzane Cavour.

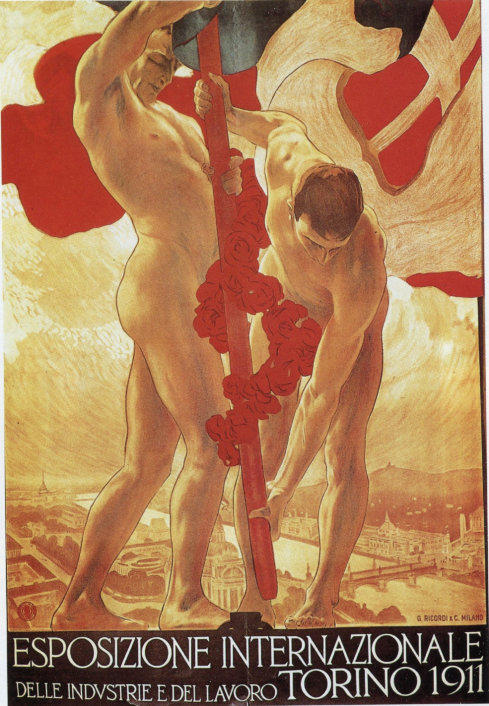
Affiche de l’Exposition Internationale des Industries et du Travail de Turin en 1911
Bibliographie
Quelques-uns des ouvrages consultés pour la préparation de ce document. Il faut y ajouter les sites Internet italiens ou français sur chaque région, ville, personnage historique, événement, etc.
- Storia d'Italia, Vol. I, I caratteri originali, Einaudi, 1972, 1064 p. ; Vol. 6, Atlante, Einaudi, 1976, 874 p.
- Storia dell'Italia repubblicana, Volume I, La costruzione della democrazia, Einaudi, 1994, 1030 p.
- Istituto geografico D'Agostini, Storia d'Italia, Cronologia 1815-1990, De Agostini, 1991, 832 p.
- Storia d'Italia, Bompiani, 1989
- Storia degli Italiani, Fratelli Fabbri, 1974
- T. Menin, Atlante Storico vol. I e II, Minerva Italica, 1979
- Cristina Vernizzi, Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino, Torino 1994, 126 p.
- Alessandro Barbero, Storia del Piemonte, dalla preistoria alla globalizzazione, Einaudi, 2008, 528 p. Orientamento bibliografico
- Gianni Oliva, I Savoia, novecento anni di una dinastia, Oscar Storia, Mondadori, 1998, 526 p.
- P. Guichonnet, Histoire de Savoie, Gardet et Garin, Annecy, s.d. (1958), 100 p.
- Histoire de l'annexion de la Savoie à la France, 1960 et nous, La Fontaine de Siloe, 2003, 352 p.
- Alain Dufour et Hyacinthe Vuilliez, Le pasteur, le saint et le roi, Théodore de Bèze, François de Sales et Henri IV, La Salésienne, Éditions Comp'Act, 2005, 94 p. (rapports entre Genève et la famille de Savoie)
- Jean d'Orville, dit Cabaret, La chronique de Savoie des origines à 1400, traduction et adaptation en français moderne par Daniel Chaubet, La Fontaine de Siloé, 1995, 304 p.
- Angelo Lostia, Storia di Torino, Newton Compton Editori, 1997, 302 p.
- Renzo Rossotti, Le strade di Torino, Newton Compton Editori, 1997, 672 p.
- Valerio Castronovo, Torino, Editori Laterza, 1987, 686 p. (L'histoire de la ville de 1864 aux années 1980)
- Città di Torino, Torino et la littérature, Torino Musei, 2002, 38 p.
- Gruppo Padano di Piadena, Le donne della filanda, Biblioteca popolare di Piadena, settembre 1977, 114 p.
- Museo del lino, Pescarolo ed Uniti, Cavaléer, la coltura del baco da seta nelle testimonianze dei protagonisti e nei documenti dell'epoca, 1979, 70 p.
- Michele L. Straniero, Antologia della canzone popolare piemontese tra Settecento e Novecento, Paravia Scriptorium, 1998, 288 p.
- Ettore Galvani, Canti popolari piemontesi, Vol.I, 1999, e II : Son tre re, canti natalizi nella tradizione popolare, Daniela Piazza Editore, 2004, 110 p.
- Costantino Nigra, Canti popolari del Piemonte, Vol. I e II, 1888, Reprint Einaudi, 1974, pp. 774, con prefazione di Giuseppe Cocchiara.
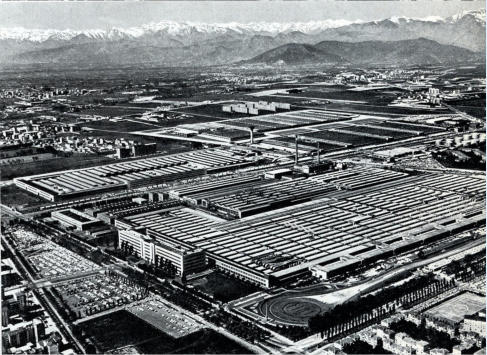
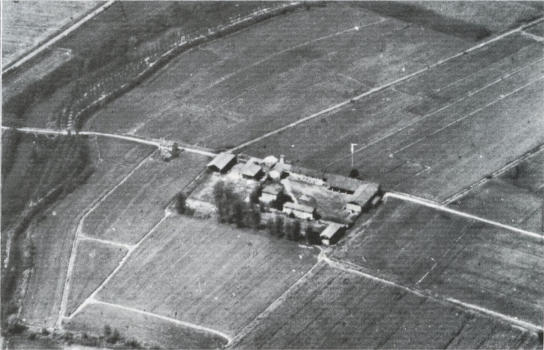
la FIAT Mirafiori & une ferme de rizière dans le Vercellese
ANNEXE - Genève et les Savoie.
À cette époque où le Piémont n’était encore qu’un appendice de la Savoie, les cantons suisses, Berne, Fribourg, étaient leur frontière, et la ville de Genève était une de celles qui refusaient de rendre hommage aux comtes puis aux ducs. Elle était pourtant au milieu de leurs possessions, le pays de Vaud, de Genève à Berne, le pays de Gex, le Genevois, le Chablais, le Faucigny, elle aurait dû être une capitale des États de Savoie. Mais les Genevois tenaient à leur autonomie communale. Genève était une de ces villes à qui les rois ou les empereurs avaient été obligés de donner une autonomie, un droit de s’administrer elles-mêmes, de créer des activités artisanales et commerciales, des échanges entre citadins et paysans des campagnes environnantes. C’était une réponse à la grande croissance démographique des XIIe et XIIIe siècles. Les Genevois avaient reçu une charte de franchise de leur évêque et prince, Adhémar Fabri, en 1387, mais ils étaient organisés en commune depuis 1291, avec l’appui du comte de Savoie contre leur évêque d’alors.
Plus tard, la plupart des communes avaient accepté que leurs maires soient nommés par le roi et que leurs droits soient imités, mais pas les Genevois. Leur résistance s’appuyait sur l’existence des cantons suisses qui s’étaient affranchis de la domination autrichienne à la fin du XIIIe siècle, et dont les foires et marchés étaient un lieu de rendez-vous entre les marchands de la Haute Allemagne et ceux de France et d’Italie, et dont l’indépendance était donc un peu la condition d’un commerce florissant ; les partisans de la liberté étaient appelés les « eidgenots », du nom des Confédérés (les « Eidgenossen »), d’où le nom français de « huguenots » ; les partisans du duc de Savoie étaient au contraire les « Mamelous » (du nom des chrétiens renégats qui formaient la garde du Grand Turc).
Les marchands allemands propagent peu à peu la réforme luthérienne dès 1526 parmi les commerçants genevois ; le courant se développe grâce aux prédications de Guillaume Farel, protégé par les Bernois qui ont adopté la Réforme en 1528. Les Genevois l’adoptent en1535, s’opposant aux ducs de Savoie et à l’évêque de Genève qui était un de leurs hommes, comme Pierre de la Baume, grand seigneur de Bresse, qui partit en 1533, laissant son siège vacant, les autorités communales s’élevant au rang de gouvernement de l’État. Les raisons de la conversion furent autant religieuses (hostilité au catholicisme corrompu dénoncé par Luther) que politiques : il s’agissait de résister aux entreprises du duc de Savoie, catholique acharné. Les guerres et les coups de force ne réussirent jamais à soumettre Genève : la guerre de la Cuiller en 1528 (ligue des chevaliers de la Cuiller, vassaux du duc de Savoie, qui avaient juré de rendre Genève au duc en jurant sur la cuillère qui leur servait à manger leur potage) se termina par un traité qui mit en gage le pays de Vaud qui serait occupé par Berne et Fribourg si Genève était à nouveau attaquée par la Savoie ; les coups de force échouèrent aussi comme celui du duc Charles III qui fit voter le Conseil général des citoyens sous la contrainte de sa garde armée ; mais à peine eut-il quitté Genève que le Conseil cassa toutes les décisions prises.
En 1536, Genève devenait protestante avec tous les villages du pays de Vaud, de Gex, Gaillard et du Chablais. Le duc de Savoie s’était allié à l’empereur Charles Quint, dont il était le beau-frère par sa femme Béatrice de Portugal, sœur d’Isabelle, l’épouse de Charles Quint. Pour le punir, François Ier envahit la Savoie, et les Bernois, à qui le duc de Savoie devait beaucoup d’argent, en profitèrent pour conquérir le pays de Vaud (qui était le gage de l’emprunt) et les baillages alentour devenus protestants. Après la victoire de Charles Quint et de son général en chef, le duc de Savoie Emmanuel-Philibert, celui-ci récupéra ses États ainsi que les terres conquise par Berne, sauf le canton de Vaud qui devint définitivement bernois jusqu’à sa transformation en canton suisse par Napoléon. Mais le Traité de Lausanne en 1564 décida que ces territoires devaient rester protestants : les terres entourant Genève redevenaient donc savoyardes mais restaient protestantes. Cela renforça l’indépendance de Genève et des terres environnantes, parfois rachetées par de riches marchands, comme la famille Budé, les descendants de Guillaume Budé, fondateur du Collège de France à Paris ; celle-ci, réfugiée à Genève parce que protestante avait acquis la seigneurie de Boisy. Certains habitants de cette région étaient restés catholiques et pratiquaient librement leur religion, et les protestants étaient protégés par la duchesse Marguerite de France, épouse d’Emmanuel Philibert, de tendance protestante comme sa tante Marguerite de Navarre.
Le successeur d’Emmanuel-Philibert, Charles-Emmanuel II voulait reconquérir Genève, enclave dans ses terres du nord-ouest, et ville de riches marchands que ses soldats seraient heureux de piller. Par ailleurs les Suisses tenaient à Genève, passage indispensable pour les soldats, montagnards pauvres qui devenaient mercenaires au service du roi de France, qui s’en était pratiquement assuré le monopole : la Franche-Comté était espagnole et l’Alsace impériale, il fallait donc passer par Genève pour rejoindre Lyon. La Suisse était fragile et devait sa coexistence entre cantons catholiques et cantons protestants à la protection du roi de France. Face à l’attaque de la ville par le duc de Savoie, en 1582, Henri III envoya ses soldats à Genève. Le duc ne renonça pas pour autant et, à plusieurs reprises, tenta d’assiéger la ville en la privant de ravitaillement, mais les contacts étaient toujours possibles par le nord avec l’Allemagne. Le duc s’empara alors du marquisat de Saluzzo qui appartenait au roi de France, et en 1588, le roi de France était pris par l’affrontement avec la Ligue ; Charles-Emmanuel prétexta qu’il venait protéger le marquisat contre les huguenots ; l’assassinat du duc de Guise par Henri III renforça l’acharnement de la Ligue ; Henri III s’allia alors avec Henri, roi de Navarre, et pour reprendre Paris aux Ligueurs, il recruta des mercenaires suisses, qu’il lança contre le duc de Savoie avec mission de reprendre le marquisat de Saluzzo. Ce fut la guerre de 1589 : en avril, les compagnies genevoises occupèrent le Chablais et le pays de Gex ; le duc de Savoie réagit en envoyant des soldats espagnols et napolitains dévaster le pays de Gex dont les villageois se réfugièrent dans la ville de Genève.
Ce fut une guerre inutile : Genève resta finalement indépendante du duc de Savoie et conserva le pays de Gex jusqu’en 1600, tandis que les Savoie gardaient le marquisat de Saluzzo, Henri IV, après avoir vaincu la Ligue obligea le duc de Savoie, s’il voulait garder le marquisat, à lui céder la Bresse. Les négociations aboutirent au Traité de Lyon, le 17 janvier 1601, selon lequel le duc gardait Saluzzo mais remettait à la France la Bresse, le Valromey et Gex, c’est-à-dire l’actuel département de l’Ain. Genève cessait donc d’être incluse dans le duché de Savoie, puisque le Rhône séparait la France de la Savoie, pour devenir une ville entre la Savoie et la France, mais la ville dut rende Gex en échange des villages de Chancy et de Aire-la-Ville.
Méprisant le Traité de Lausanne de 1564, Charles-Emmanuel tenta alors de « recatholiciser » le Chablais et le mandement de Gaillard ; il y envoya un prédicateur remarquable, le jeune prévôt de l’église d’Annecy, François de Sales, qui convertit un gentilhomme connu, Antoine de Saint-Michel, sieur d’Avully. Celui-ci, devenu catholique, s’attaqua à Théodore de Bèze, alors très âgé ; les débats publics organisés entre théologiens protestants et catholiques tournèrent au profit des catholiques et, contre le gré des Genevois, la région redevint catholique. Charles-Emmanuel pensa alors que le moment était venu de tenter la reconquête de Genève, et dans la nuit du 21 décembre 1602, il lança secrètement des troupes d’élite à l’assaut des murs de la ville, avec échelles à roulettes feutrées pour ne pas faire de bruit ; l’alarme fut donnée, et les troupes du duc de Savoie durent se retirer ; les Genevois exécutèrent les prisonniers comme des larrons qui avaient attaqué la ville en pleine paix, sans déclaration de guerre. Ce fut la nuit de « l ‘Escalade ».
D’autres escarmouches eurent lieu, mais le Traité de Saint-Julien en juillet 1603 stabilisa définitivement la situation et les rapports entre catholiques et protestants dans cette région. Les frontières entre la Savoie et Genève furent reconnues au Traité de Trin le 3 juin 1754. Après l’occupation napoléonienne, Genève retrouva son indépendance le 31 décembre 1813.
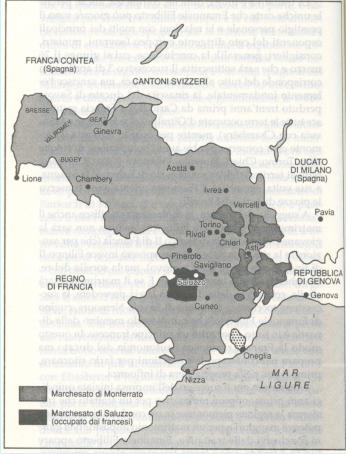
États de Savoie en 1559 après le Traité de Cateau-Cambrésis. Genève = Ginevra ?

Théodore de Bèze, 1519-1605, converti au calvinisme en 1548, devint le principal collaborateur de Calvin à qui il succéda à sa mort en 1564 dans ses charges à Genève.